Consensus dans le cyberart
La tradition du cyberart est aussi riche dans sa pratique que dans sa littérature. Et certains ouvrages ont la vertu de nous offrir une synthèse à la fois théorique et historique de cette forme d’art basée sur le dialogue homme-machine. La technologie dans l’art, d’Edmond Couchot en est un bon exemple, ainsi que l’ouvrage d’Olga Kisseleva, Cyberart, un essai sur l’art du dialogue, parus tous les deux en 1998. Ce dernier a la particularité de refléter de manière insistante, un discours propre au cyberart qui s’articule autour des notions de communication, de création collective, d’interactivité, etc. Aux propres affirmations de l’auteure s’ajoutent aussi celles de nombreux théoriciens et artistes rattachés à la tradition des arts médiatiques. Cela dit, on est étonné de constater à quel point certains concepts font l’objet d’un consensus, des concepts qui, pourtant, ne semblent pas nécessairement aller de soi ou, en tout cas, méritent d’être remis en question. Une des notions consensuelles du cyberart tourne autour de l' »expérience » : l’art basé sur les nouvelles technologies interactives suppose une implication active du spectateur au point où le processus dialogique l’emporterait sur l’identité des objets et des sujets mis en cause. Ainsi, le processus primerait sur le résultat. Or, cette conception du cyberart semble entrer en conflit avec celle, appartenant à l’art traditionnel qui valorise autant les oeuvres que le jugement critique sur celles-ci. Nous allons donc débattre de ces questions de l’identité et de l’expérience et tenter de démontrer que la participation du spectateur se fait sur plusieurs niveaux. Notre démarche est nourrie par le doute face au danger des consensus généralisés, source de normalisation des pratiques et des discours risquant de limiter un univers pourtant caractérisé par l’infinité des ses possibilités.
L’expérience comme nouveau paradigme
À travers les nombreux exemples d’oeuvres, de citations et de commentaires théoriques, l’auteure cherche à définir les caractéristiques propres au cyberart. D’abord, grâce à la virtualité du numérique et de sa possible diffusion en réseau, l’oeuvre cyberartistique est avant tout acte de communication. Celle-ci se distingue de toute autre forme d’art puisqu’elle est le lieu du dialogue incluant l’objet numérique, les spectateurs et l’artiste. L’interactivité est donc incontournable lorsqu’on parle du cyberart.
Cela dit, une autre notion semble aussi incontournable, soit celle d' »expérience », lorsque Kisseleva – et nombre d’auteurs à qui elle fait référence – par le d’interactivité. Ce nouvel art de l’interactivité a transformé la perception contemplative en expérimentation : « les oeuvres interactives sont à vivre […] » (Kisseleva, 1998, p. 59), et ce, au point où l’objet devient secondaire. C’est particulièrement le cas avec le net-art : « le net-art n’est pas un objet fixe, il est disséminé en réseaux électriques, il flotte « dans les airs » » (Kisseleva, 1998, p. 323). L’expérience devient ainsi le paradigme du cyberart et, peut-être, en grande partie celui de l’art contemporain ou moderne : « Le but du cyberart n’est pas forcément la création d’une oeuvre, il peut être aussi son expérimentation. L’expérimentation reste d’ailleurs le domaine privilégié de l’art contemporain au XXe siècle » (Kisseleva, 1998, p. 81). L’implication du spectateur est sans contredit le dénominateur commun de bien des manifestations artistiques de ce siècle comme celles des dadaïstes, des constructivistes russes, de Fluxus et des happenings, de la performance, de l’installation, etc. Des formes d’art caractérisées par leur aspect collectif et souvent « théâtral ».
À ce titre, interaction et expérimentation sont comparées à la participation : « Dans le contexte de l’art contemporain, le terme « participation » désigne finalement la relation entre le spectateur et une oeuvre d’art achevée tandis que celui d' »interaction » implique une relation réciproque entre l’utilisateur et un système « intelligent » » (Kisseleva, 1998, p. 64).
Participation ou interaction
On se demande toutefois ce qu’il reste, dans la ou les théories du cyberart, de cette notion très complexe de la participation associée ici à l’art contemporain. Notion qui sous-tend la part active du spectateur face à l’oeuvre, qu’elle soit interactive ou non. Si, comme le rappelle Kisseleva, c’est le regardeur qui fait le tableau (Duchamp) et que le lecteur est aussi « producteur du Texte » (Barthes), cela suppose non seulement la jouissance esthétique mais aussi le non moins inépuisable travail d’interprétation et d’analyse critique. Mais quand vient le temps de comparer les oeuvres dites achevées à celles propres aux « systèmes intelligents », il semble que la « participation » et « l’interaction » deviennent des concepts exclusifs l’un de l’autre. Par exemple, à quel point l’opposition oeuvre close-oeuvre ouverte mène-t-elle à la conclusion que l’oeuvre ouverte permet, de manière inédite, au participant de se voir « investi d’une responsabilité dont la division traditionnelle des rôles l’avait jusque-là déchargé » (Jérôme Glicenstein, cité par l’auteure)? Contempler jusqu’à l’extase ou analyser jusqu’au moindre motif le tableau dans le musée, n’est-ce pas le fait d’une implication du spectateur? Certes, on admet volontiers que l’interactivité du cyberart engage et responsabilise d’avantage l' »utilisateur » puisque la perception même de l’oeuvre est impossible sans qu’elle soit actualisée par un processus dialogique. Mais ne serait-il pas aussi approprié de parler de différence de degrés – la simple contemplation passive, par exemple, comme premier degré de l’interaction – en même temps que de différence de nature – interactivité de nature technique ou mentale? Car il importe de bien distinguer l’interactivité permise par la technologie – le dialogue entre l’homme et les systèmes computationnels – et l’activité interprétative et critique qui, elle aussi, établit des liens, configure des noeuds, ayant pour effet de transformer à la fois le statut du sujet percevant et l’objet perçu.
De plus, on se questionne sur la valorisation de la relation et de l’intervalle propre à l’expérimentation, car elle se fait au détriment de l’identité de l’objet et surtout du sujet, si indéterminé et déterritorialisé que soit ce dernier, une fois prolongé par les médias numériques. On voit là une autre manière de dire que le processus l’emporte sur le résultat dans la mesure où ce qui est entre les éléments importe plus que les éléments eux-mêmes. Sur cette idée de relations, les propos d’Edmond Couchot sont exemplaires :
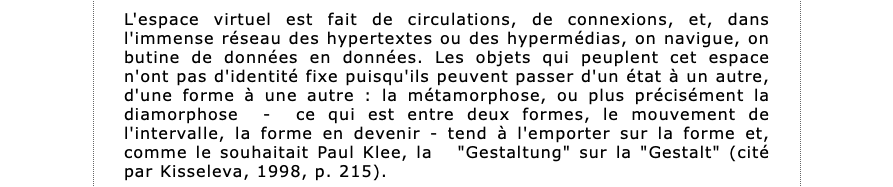
Et en affirmant, par ailleurs, que « l’interactivité se présente surtout comme un territoire de l’expérience plus que celui de l’interprétation » (Kisseleva, p. 81), on nous invite peut-être à se débarrasser de nos vieilles habitudes rationalistes et à penser que la perdition dans l’expérience remplacera l’approche sécurisante et souvent réductrice de l’interprétation et de l’analyse. Car l’interactivité remet en cause notre conception de l’art, nous dit Kisseleva; il en découle que « […] l’industrie culturelle, l’exposition dans le contexte institutionnel et le commentaire de tierces personnes par l’intermédiaire de la critique et de l’esthétique n’ont plus lieu d’être » (Kisseleva, 1998, p. 80). Cependant, il n’est pas certain que l’exclusion du commentaire au profit de l’expérience interactive comme nouveau paradigme de l’art soit nécessairement des plus productive. Peut-on ainsi faire fi des jugements de valeur esthétique?
Expérimentation et jugement esthétique
De toute évidence, cet essai « sur l’art du dialogue » abandonne, pour ne pas dire rejette, le parti pris critique au profit d’une approche plutôt relativiste, où toutes les oeuvres méritent au moins d’être décrites. Ce qui n’enlève rien à la pertinence de l’ouvrage comme outil de référence incontournable. Il est en effet parsemé de nombreux exemples qui donnent une bonne vue d’ensemble de la tradition des arts médiatiques (on regrette à ce titre l’absence d’un index des noms). Un livre peu engagé mais bien documenté donc, plus proche de la typologie que de l’anthologie. Car tout ce foisonnement très large de productions donne l’impression que le cyberart procède selon une logique de l’addition plutôt que celle de la sélection. Toutes les oeuvres se valent, semble-t-il, on passe d’une à l’autre et, ainsi, les expériences s’accumulent comme les sous dans la tirelire. Mais pour faire une anthologie, il faut des critères, même implicites, de sélection, ou établir une échelle de valeur qui doit certainement s’appuyer sur une forme de réflexion.
Dans Critères esthétiques et jugement de goût, Yves Michaud tente de contrer ce relativisme absolu de la pluralité des expériences esthétiques (sans critère esthétique, tout se vaut) pour défendre plutôt un relativisme dit « objectiviste », inspiré de la philosophie de David Hume (Essai sur la norme du goût, 1757, une réflexion fondée sur l’éducation du goût1. L’appréciation ou l’expérience des oeuvres d’art est relative au contexte toujours local des jeux de langage. Ces derniers supposent une correspondance entre les jugements esthétiques et les traits réels des objets, ce qui demande un ancrage du discours critique dans les oeuvres. « Cette manière de mettre en relation qualité artistique et expérience esthétique est, en fait, ce qui permet d’échapper au relativisme complet du goût tout en faisant place à ses variations – qui sont tellement évidentes » (Yves Michaud, 1999, p. 41).
En partant de cette approche, il est possible de comprendre pourquoi le couple expérimentation-interactivité en arrive à exclure celui de la participation-interprétation. L’expérimentation, et le jeu des relations qu’elle suppose, nous projette dans un relativisme absolu lorsqu’il n’est plus possible d’élaborer, comme le croit Olga Kisseleva, une expérience d’évaluation face à la diversité2. Selon la thèse de Michaud, cette expérience d’évaluation n’a de sens que s’il y a correspondance avec un objet. Or, il advient que, dans bien des théories sur le cyberart, l’objet n’a plus d’importance; pourtant, « […] une fois posée cette correspondance de principe entre expérience esthétique et qualités artistiques dans l’objet, le processus de formation du jugement esthétique consiste à apprendre à faire correspondre une réaction appropriée à des qualités appropriées » (Yves Michaud, 1999, p. 41). Si, dans le nouveau paradigme du cyberart, il y a correspondance, elle se situe entre la dévalorisation de l’objet, d’une part, et le préjugé défavorable envers toute forme de jugement critique, d’autre part. Et comme le souligne Michaud :
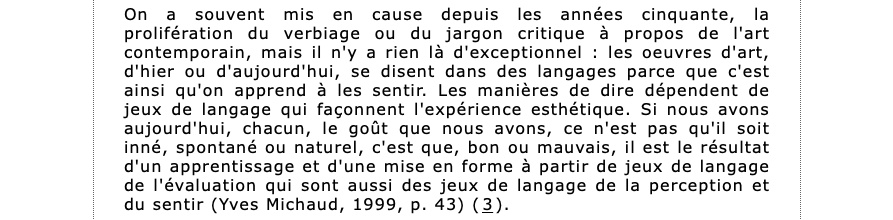
Rien ne nous empêche donc de mettre en pratique ces jeux de langage pour le cyberart. Existe-t-il, par exemple, des oeuvres plus pertinentes que d’autres? Y a-t-il des productions plus ouvertes, plus riches en virtualités, en questionnements que d’autres? Ou bien, peuvent-elles être closes du point de vue de leur expérimentation tout en offrant un « infini de possibilités » d’interprétations. Enfin, une oeuvre peut-elle être indéterminée, collective, ouverte jusqu’à la banalité? Si, au sein des jeux de langage, l’efficacité de l’oeuvre d’art se mesure à ses effets, on doit admettre que les productions les plus riches sont probablement celles dont les effets ne sont pas mesurables dans l’immédiat, par opposition aux choses plus simples, rapidement consommées – sans parler des oeuvres qui dissimulent leur pertinence sous le couvert de la superficialité. Bref, pour comparer, il faut cerner l’identité des objets afin d’établir un dialogue entre ceux-ci. Cependant il est clair que, du point de vue pragmatique, les identités sont moins prégnantes quand domine le jeu des relations. Mais d’une certaine façon on ne peut passer à côté du fait que l’interactivité de l’hypermédia est en soi un trait d’identité très marqué du cyberart. Cela nous amène à approfondir la question du jeu, en suivant les propos de Kisseleva dans un chapitre consacré aux productions apparentées aux jeux interactifs :
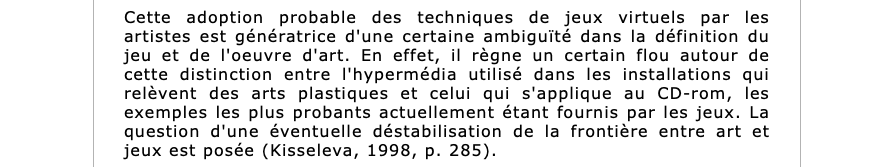
La métaphore du jeu
L’interactivité et le ludique, comme spécificité du cyberart – et du net-art en particulier4 – sont donc partagés avec les produits plus commerciaux que sont les jeux électroniques, sans oublier les cédéroms, les systèmes experts (programmes de simulation de l’intelligence humaine dans un domaine spécialisé) et de nombreux sites Web, etc.
Y a-t-il une différence entre l’art numérique et les jeux de rôle en ligne, les Game Boy et les tamagotchis? Les MUDs (jeux interactifs en réseau), par exemple, ne sont-ils pas plus près de cet idéal de la création collective, celui qui motive la création d’environnements ludiques à prétention artistique? Les premiers sont, en tout cas, beaucoup plus répandus et plus massivement utilisés que toutes les tentatives imaginées par les artistes. Ils répondent par ailleurs aux exigences de l’art sociologique qui valorise la démocratie dans la mesure où « […] l’utilisation des réseaux de communication multimédias permet un développement élargi de l’art sociologique » (Kisseleva, 1998, p. 91). Si, d’un côté, l’art en réseau est, pour certains, l’aboutissement de l’art sociologique, l’industrie très prospère des jeux électroniques, d’un autre côté, démontre manifestement que la démocratie passe d’abord par les goûts et les intérêts du citoyen, bien avant les utopies collectivistes fondées dans les années 1960 et que l’on croyait enterrées5.
De quelle façon alors la notion de jeu dans le cyberart se distingue-t-elle de celle appartenant aux produits commerciaux? Gageons que les oeuvres dont la valeur critique est la plus forte, risquent le plus de se démarquer. C’est-à-dire, des oeuvres qui, au delà de l’immédiateté de l’expérience vécue, ont pour caractéristique de décortiquer les codes appris6, de récrire les règlements et de transformer celui qui fait cette expérience. Ainsi, le jeu ne réduit pas nécessairement l’art à une expérience innocente. La métaphore peut aussi tenir compte du pouvoir transformateur de l’art, comme en témoigne l’herméneutique d’Hans-Georg Gadamer, qui identifie le mode d’être du jeu à l’expérience de l’art :
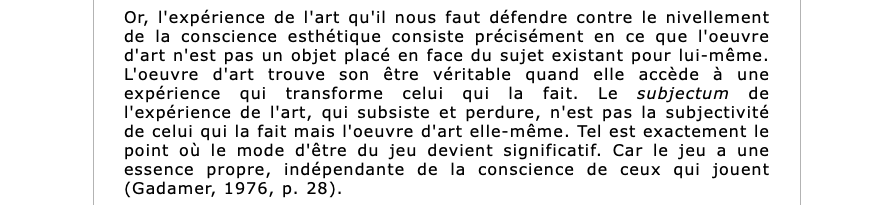
La métaphore du jeu suggère ici que l’utilisateur, en participant au jeu de l’intelligence collective, est celui qui oublie sa subjectivité tout en s’engageant dans l’oeuvre avec sa sensibilité, ses organes de perception et, parfois, son corps tout entier. Mais peut-il être réceptif tout en restant distant, et ce, en conservant sa capacité de traiter ou d’analyser l’information en vue de nourrir une conscience singulière? Pour paraphraser Gadamer, disons que la conscience de ceux qui jouent a aussi son essence propre, indépendante du jeu. Les propos de Pierre Lévy semblent également aller dans ce sens : « Loin de fusionner les intelligences individuelles dans une sorte d’indistinct magma, l’intelligence collective est un processus de croissance, de différenciation et de relance mutuelle des singularités » (Pierre Lévy, 1997, p.33). Et plutôt que de parler d’expérience, Lévy insiste plutôt sur la valeur créative de la communication quand il est question d’une esthétique de l’intelligence collective. C’est pour lui la meilleur façon d’inventer et de structurer les langages : « L’art de l’implication, qui ne pourra donner toute sa mesure que dans le cyberspace, en organisant le cyberspace, se veut thérapeutique. Il invite à expérimenter une invention collective du langage qui se connaîtrait comme telle. Ce faisant, il pointe vers l’essence même de la création artistique » (Pierre Lévy, 1997, p.124).
Pour en revenir au jeu, on comprend que le plaisir ou le désir de jouer réside dans l’évasion et l’oubli de soi. Ce plaisir est ordonné par la contrainte et les règlements que le joueur accepte et intègre. Il apparaît, par contre, que le jeu de l’art se fasse sur les deux plans, celui de la jouissance esthétique et celui consistant à reconfigurer les règles ou les critères7. Ce qui fait de chaque oeuvre une expérience singulière, une énigme qui, comme celle du Sphinx, a souvent pour effet de nous ramener les pieds sur terre.
De la sorte, l’expérience de l’interactivité doit se prolonger dans les consciences. Ces dernières, en modulant les données, prennent connaissance et intègrent les déplacements qui s’opèrent dans les propositions des artistes. Ces « problèmes » engendreront à leur tour des solutions qui auront pour vertu de transformer, ou de dynamiser le monde du cyberart. Ce dynamisme ne peut reposer sur la simple multiplicité des expériences. Pour qu’il y ait des relations et des intervalles, il faut qu’il y ait des raccordements plus ou moins solides. Pour les construire, nos sens ont peut-être besoin aussi de la raison. Il n’y a pas de liens sans noeuds et l’expérience pratique doit avoir une signification ou une certaine valeur d’apprentissage, sur laquelle la « communication » puisse se fonder.
« Le propre de l’esthétique de la communication est de ne pas être une théorie, mais bien une pratique », nous dit encore Olga Kisseleva (p. 98). Cette affirmation8 présuppose une distinction (qui n’a rien d’absolue) entre les domaines de la pensée et de l’action – un problème typique du cyberart -, distinction qui, curieusement, nous replonge directement dans le discours théorique, comme le poisson incapable de sortir de l’eau. Quoiqu’il en soit, on a peut-être pas fini de voyager entre la sphère de l’intelligible et celle du vécu en vue d’instituer des jugements de valeur esthétique qui tiennent aussi compte de la part d’indécidable, d’insaisissable propre à toutes créations artistiques. Cependant, il semble que l’on soit ici confronté à une théorisation qui se fuit ou qui se limite du même coup, une théorie sur le cyberart que l’on voudrait plus « ouverte » sur les jeux de langage. Ceux-ci agissent souvent comme contraintes modulant l’inspiration des génies comme celle des apprentis! Peut-on penser que ce jeu de réciprocité entre ouverture et fermeture puisse engendrer une cybercommunauté dynamique9? Cela dit, parler du cyberart comme simple expérience ludique et créative est l’exemple d’un jeu de langage quelque peu contraignant, dans lequel l’art pert beaucoup de points.
Notes
[1] Bien que la thèse soit pertinente pour le cyberart, il est à noter que Michaud s’adresse ici exclusivement au milieu peut-être irrécupérable de l’art contemporain institutionnalisé, qui souffre du syndrome du relativisme absolu, lui même relatif, sans doute, à « un jeu de langage épuisé »!
[2] La catégorie .net (l’art sur Internet) des Prix Ars Electronica est un autre exemple de relativisme absolu : dans l’impossibilité d’établir des jugements de valeur esthétique, rien n’a de valeur! On se rabat alors sur une vision instrumentale de la création collective. À ce sujet, lire mon article Les Prix Ars Electronica 1999 : le choix des oeuvres et la méthode, paru sur Archée.
[3] Michaud reprend ici la notion de jeux de langage à partir des Investigations philosophiques de Wittgenstein : « J’appellerai aussi l’ensemble que constituent le langage et les actions dans lesquelles il est inscrit le « jeu de langage » » (Wittgenstein cité par Yves Michaud, 1999, p.72). Michaud ajoute : « En restant fidèle à ces idées, on peut soutenir alors qu’un jugement esthétique fait partie d’un jeu de langage d’évaluation et de communication – un jeu de langage esthétique pourrait-on dire. Ce jeu est un jeu de langage parmi d’autres : il y a de multiples jeux de langage esthétiques selon les objets à évaluer et les groupes qui les pratiquent; certains sont vieillis et passés, vieillots ou en train de vieillir, d’autres en train de s’inventer, d’autres encore à inventer. […] L’invention et l’élaboration se font à travers des interactions au cours desquelles des règles d’usage nouvelles sont essayées, adoptées ou rejetées » (Yves Michaud, 1999, p. 74).
[4] « Le net-art est proche des jeux électroniques. Selon beaucoup de paramètres, l’oeuvre « cyber » artistique est souvent un jeu d’ordinateur » (Kisseleva, 1998, p. 324).
[5] C’est l’exemple de Vous êtes tous des créateurs ou le mythe de l’art, du contestataire Yves Robillard qui croit que « […] l’importance accordée aux artistes va être transférée à la nécessité d’instaurer des ateliers de créativité pour tous, et à leurs animateurs (p. 9). » Son hypothèse est que le concept très institutionnalisé de l’art s’alimente par le mythe du génie et de l’esprit critique. « Le mythe du génie est le côté pile, ou la biface, du grand mythe ou premier mythe de l’époque industrielle, l’esprit critique réductionniste. Le mythe de l’art-génie a eu comme effet d’aliéner le pouvoir de créativité de chaque individu en le réservant à une catégorie particulière, les artistes créateurs. Il y eut alors d’un côté les créateurs, de l’autre les spectateurs. » Le mythe du génie est remplacé par le mythe de la créativité pour tous qui, ici aussi, trouve son essence dans le jeu (« Et l’esprit du jeu est l’essence même de la créativité »(Yves Robitaille, 1998, p. 14)). Quand à l’esprit critique, Robitaille le remplace par l’expérience vécue : « Ce n’est pas l’intentionnalité de l’artiste qui m’intéresse, c’est ce que je ressens à la vue de ce qu’il fait ou de tout autre objet, ce besoin de me situer dans mes sensations par rapport à tout ce qui existe en dedans et en dehors de moi et que l’expérience soit vécue dans le corps et l’être tout entier, et non seulement sur le plan intellectuel. C’est cela, le domaine de l’esthétique (Yves Robitaille, 1998, p.14) » Voilà de quoi inspirer les vendeurs de jeux électroniques!
[6] « Quand les règles sociales changent subitement, les comportements et les rites jusqu’alors admis apparaissent rigides et arbitraires comme le déroulement et les modèles d’un jeu » (Marshall McLuhan, 1993, p. 369). Et dans le même ordre d’idées : « L’art, sous toutes les formes qu’il prend, est une activité codifiée dont le code est continuellement en cours d’élaboration – c’est un processus. Devenir un artiste, c’est apprendre à opérer selon ces ensembles de règles et à élaborer sur elles » (Michaud, 1998, p. 38).
[7] L’analogie entre l’art et le jeu a donc ses limites. La même conclusion apparaît quand Lévy discute de la notion d’identité, en comparant le jeu électronique et l’intelligence collective : « Un jeu vidéo est régi par des règles fixes, quand un intellectuel collectif remet en jeu constamment les lois de son cosmos immanent. Un jeu vidéo a été imaginé par un concepteur; en revanche, les membres d’un intellectuel collectif sont à la fois les concepteurs de leur cosmos et les héros des aventures qui s’y déroulent : il n’y a plus ici de séparation nette entre l’exploration et la construction du monde virtuel (nous soulignons) » (Pierre Lévy, 1997, p. 153)
[8] Affirmation qui n’est pas représentative de la démarche très théorique du Groupe de l’esthétique de la communication (animé entre autres par Derrick de Kerckhove, Mario Costa et Fred Forest). À preuve, cette citation qui ne manque pas d’à-propos : « L’artiste est aussi un homme et un témoin engagé dans l’aventure d’une époque. Il ne peut ignorer, il ne peut échapper aux transformations radicales qui la secouent. Sa qualité d’artiste le place devant la nécessité impérative d’en saisir le « sens » et d’en formuler les « langages » » (Fred Forest, p. 35). On peut lire plus loin : « L’artiste de la communication va tenter de traduire la nouvelle réalité du monde dans un langage transposé dont il établira les codes » (Fred Forest, 1995, p. 38).
[9] « L’art et les jeux ont besoin de règles, de conventions et de spectateurs. Ils doivent se détacher de l’ensemble de la situation, en être des modèles, sinon le sens du jeu disparaît. Le « jeu », en effet, celui des hommes ou celui d’une roue, implique une réciprocité » (Marshall McLuhan, 1993, p. 372).
Bibliographie
– Couchot, Edmond, La technologie dans l’art : de la photographie à la réalité virtuelle, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1998, 271 p.
– Forest, Fred, « Manifeste pour une Esthétique de la communication », dans Esthétique des arts médiatiques, Tome I, sous la direction de Louise Poissant. Sainte-Foy, Presse de l’Université du Québec, 1995, p. 26-61
– Gadamer, Hans-Georg, Vérité et méthode : les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris, Éditions du Seuil, 1976, 346 p.
– Kisseleva, Olga, Cyberart, un essai sur l’art du dialogue, Paris, L’Harmattan, 1998, 365 p.
– McLuhan, Marshall, Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l’homme, Bibliothèque québécoise, 1993, 561 p.
– Michaud, Yves, Critères esthétiques et jugement de goût, Paris, Éditions Jacqueline Chambon, 1999,121 p.
– Lévy, Pierre, L’intelligence collective : pour une anthropologie du cyberspace, Paris, La Découverte, 1997, 245 p.
– Robillard, Yves, Vous êtes tous des créateurs ou le mythe de l’art, Outremont, Lanctôt Éditeur, 1998, 209 p.
