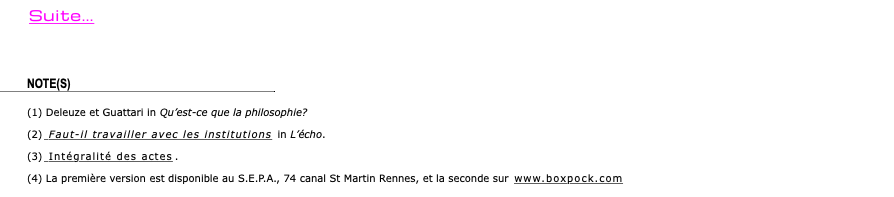Il y a, entre ma pleine adhésion à la Licence Art Libre et ce qui fut depuis son origine ma pratique de l’art, toute l’imperceptible distance qui sépare la morale de l’éthique, l’édiction d’un discours organisant, collectif, le poids d’une parole légiférante ; disons donc que si, au fond, la façon dont jusqu’ici je diffusais mes travaux n’a pas été modifiée par cet acquiescement aux règles du Copyleft, c’est la nature de l’énoncé qui en accompagne le cours qui est décisive. Ce qui, jusqu’à aujourd’hui n’était que la forme accidentelle, inévitable cependant, d’une inaptitude aux règles du jeu (et peu importe au fond qu’elle soit le fruit d’une radicalité héroïque ou de la stupeur tremblante devant l’invariabilité des rapports de force dans tous les groupes sociaux) devient alors une déviation manifeste à la violence que ces règles font à l’idéal d’intégrité de tout artiste.
La première force attractive de la Licence Art Libre fut donc pour moi celle de l’énoncé qui, au même titre que l’idée d’un roman n’est pas un roman, fit d’une simple circonstance un enjeu politique. Restait à dégager ce qui, dans la nature de cet énoncé, pouvait à son tour devenir matière de travail, être susceptible de se fixer plus loin que la membrane sociale et politique, à la périphérie des œuvres, et devenir à son tour objet d’atelier ou, mieux encore, machine de production.
Les articles 2.1 et 2.2, relatifs à la liberté de copie et de diffusion, de ce point de vue, tiennent plus de la profession de foi aimable que de la réforme ou de l’invention ; bien entendu, on n’a pas attendu le copyleft pour se rendre disponible un modèle de libre échange et de reproduction ouverte des oeuvres : qu’il s’agisse de la revue situationniste Potlatch qui invitait dans les années 50 ses lecteurs à reproduire et distribuer leurs exemplaires pour couper court à toute tentative de collection, ou encore, en 1972, de l’envoi de La langue slave dans lequel Michel Vachey, pratiquant la version la moins civilisée du cut-up, précisait que sa “ pensée n’étant ni légale ni déposée, il n’y a donc pour ce livre aucun dépôt légal ”, j’imagine que chacun pourrait compléter sans peine la liste de ces effractions faites à l’économie qui sont au travail dans l’art moderne depuis un siècle.
Toute oeuvre d’art est appelée à être engouffrée dans le vaste domaine des plagiats ou des artisanats, de la citation plus ou moins abusive au mastic destiné à combler l’imagination sidéralement lacunaire des publicitaires; toute grande oeuvre finit tôt ou tard par devenir un pot de chambre fleuri entre les mains d’un public dont la moindre qualité est d’avoir le goût exclusivement posthume ; et, surtout, quand un artiste se soucie lui-même avec trop d’empressement de protéger ses oeuvres contre la duplication, c’est qu’il précède la nature artisanale de son oeuvre en supposant que sa reproductibilité en ruinerait le sens. En vérité, la pratique de l’art se définissant principalement dans la sphère de l’invention du sujet pour lui-même — par cette effectuation en “ agrégats sensibles1 ” des liens singuliers qu’il tisse avec le monde pour se le rendre habitable — on comprend aisément que sa reproduction ne met en péril que l’intégrité du copieur, qui y perd tout ce que l’art pourrait lui offrir d’enrichissement ; c’est l’emprunteur qui y laisse sa substance, pas le créateur.
C’est surtout en tant que structure participative et projet territorial bien plus que comme plate-forme d’échanges que m’intéresse le Copyleft ; ceci a fortiori parce que cette dernière proposition, la disponibilité des banques inertes, est basée sur l’actuel modèle communiquant, dont la conception du monde et de la place du sujet dans celui-ci ont sur l’art des effets assez désastreux pour le piéger systématiquement dans la sociologie2 (il s’agit, ni plus ni moins, d’un charlatanisme de l’unité mystique, de l’immanence des universaux supposés du discours qui habiterait cet “ être ” dont l’humain est le berger. Cette apparente générosité a surtout pour mission d’aplanir toutes les singularités au profit d’une uniformisation des énoncés, qui camoufle mal que sous le terme d’ouverture s’abrite un fantasme solide des équivalences).
J’ai pour ma part, à ce jour, puisé dans la Licence Art Libre par deux fois pour y trouver un modèle de grammaire (un modèle ergologique), dans lequel le Copyleft toucha, pour la première, à la diffusion et à l’usage du concept philosophique comme objet modulaire et transformable — ce fut la publication des actes du colloque De l’humour libéral ou l’invention de l’idiot moderne3 — et, dans la seconde, de la partition ouverte — la réalisation du CD Strabisme avec Vincent Matyn —, sans vraiment me pencher sur le libre-service des éléments (modèle logistique), qui n’invente à mon sens aucune nouvelle donne artistique par rapport au collage, au cut-up ou encore au brassage des samples (il s’agit, je le répète, d’une conclusion purement technologique, qui ne tient pas compte de l’importance que j’accorde à l’énoncé qui suppose un entretien entre la source et l’usager). Il s’est agit pour moi de privilégier l’aspect dynamique qui conduit, à chaque aventure du matériau, à devoir le repenser entièrement dans sa nature même, plutôt qu’à en défendre l’usage libre (qu’est-ce que signifierait, d’ailleurs, cet emploi-là du Copyleft pour le producteur que je suis, disposition largement redondante en regard de l’infinie variation des possibles de la déjà disponible banque des données sur lesquelles se bâtit toute oeuvre d’art? Si la place du sujet doit rester prépondérante, c’est bien en termes dynamiques qu’il faut l’entendre, ceux de la production elle-même, et non ceux de l’outillage : l’objet produit, l’oeuvre, comme le matériau, n’ayant d’autre valeur que testimoniale pour le trajet qui le précède, il est, conceptuellement — et peut-être artistiquement —, vide).
Ainsi, la libre disposition du code source pour le livre De l’humour libéral ou l’invention de l’idiot moderne, est une tentative de renouement avec la pratique du commentaire telle qu’elle était déjà en cours dans la grande bibliothèque d’Alexandrie : rouvrir les parenthèses de Zénodote d’Éphèse (bibliothécaire, 320-240 av. J.C.) et — comme s’accumulaient sur les trop rares et trop chers volumen textes originaux, commentaires, notes, gribouillis, palimpsestes hâtifs —, laisser se creuser le texte de vacuoles prêtes à accueillir les fils enchevêtrés de pensées enchaînées aux concepts établis dans le texte liminaire. L’aventure d’un concept, s’il est vraiment ce noyau radical de l’invention philosophique et que cette invention est bien la définition-même du travail philosophique, est vouée à la mise à l’écart : il devient objet, et comme tel finit par rejoindre un vaste plan de travail où règne l’indistinction. Mais, ainsi saisi dans le corps de son texte géniteur soumis au Copyleft, sans qu’il doive le quitter pour se perdre dans l’exégèse, il peut devenir matière vive : sujet. La contradiction, le contre-argument, l’étayage, l’éclaircissement ou l’éclairage, viendront, de refonte en refonte, le féconder dans une mitose infinie, laissant derrière ces étapes autant d’états du texte qu’il y aura eu d’étape pour la pensée, pour l’usage des concepts dégagés pas à pas de la première mouture. Nous assisterons ainsi à un double développement, cas rare à observer dans le cheminement des idées, celui d’une verticalité diachronique qui conduit à une somme d’interventions, et celui d’une horizontalité éclatée, celle de la synchronicité des accaparements des concepts dans des voies diffuses et peut-être contradictoires, paradoxales.