Les « traversées culturelles » que propose l’ouvrage sont autant de « ponts » jetés vers la connaissance d’une poétique moderne en crise. A partir du préfixe « trans- », qui peut signifier ce qui traverse, ce qui chevauche, ce qui se transforme ou ce qui se situe au-delà (10), Vallée et Klucinskas forgent le néologisme de « transcepts » (17) pour qualifier la richesse des apports scientifiques de Walter Moser, « pionnier » des études transculturelles. Ils retracent, dans une substantielle introduction, sa progression intellectuelle, de son projet « d’archéologie des crises de la modernité », à travers la poésie encyclopédique de Novalis et le roman-essai de Musil surtout (12), jusqu’aux notions plus récentes de transfert, de motion et de mobilité dans le contexte actuel de mondialisation et de révolution médiatique, en passant par son étude des « recyclages » postmodernes à partir d’une pensée du déchet et de l’oubli, enjeux d’identité politique et culturelle fondamentaux à l’heure de l’hyperconsommation et de l’hypermnésie, ou encore par sa redéfinition du baroque comme « processus à la fois transculturel et transhistorique » qui « ressurgit » dans l’histoire avec d’innombrables « valences sémantiques » (14).
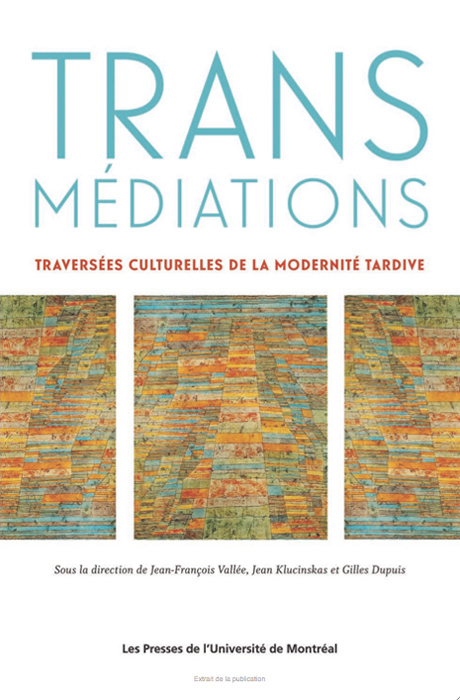
Les contributions, dont les objets sont pourtant variés, se répondent d’une partie à l’autre et donnent une vue précise de la pratique de la littérature comparée aujourd’hui. Elles se répartissent en quatre parties fort équilibrées, avec une gradation du plus vers le moins quant aux liens avec les principaux champs de recherche mosériens. La première partie, « Recyclages et transferts culturels », traite des migrations conceptuelles et politiques internationales illustrées au cinéma, dans la littérature, ou présentes dans l’imaginaire de la ville. La deuxième partie, « Postromantisme, baroque et Spätzeit », prolonge logiquement la réflexion sur les transferts géographiques par les transferts temporels, d’une mémoire à travers l’histoire, la littérature, la traduction, la peinture, ou le film apocalyptique. La troisième partie, « Esthétique et herméneutique », interroge les fondements de la culture et de l’histoire, autour des « valeurs » du désintérêt, de la complexité, ou encore du style littéraire ou filmique, tandis que le dernier volet de l’ouvrage, intitulé « Philosophie et littérature comparée », ouvre plus largement sur les enjeux philosophiques et comparatistes de la modernité (théories post-religieuses, identité et littérature francophone en Amérique du Nord, conception d’un langage philosophique moderne, dénationalisation de la littérature et des concepts littéraires).
Bien loin d’échouer, comme les directeurs le craignent, à montrer les liens transversaux souterrains qui lient la diversité des articles, c’est l’instabilité et l’hétérogénéité mêmes du préfixe « trans » qui confèrent sa solidité scientifique et sa cohésion intellectuelle au livre (20).
« Recyclages et transferts culturels »
Le premier article de Mieke Bal offre une discussion subtile sur la « migration conceptuelle » du thème de l’hospitalité dans Talo(La maison), court-métrage de la cinéaste finlandaise Eija-Liisa Ahtila, projeté à Kassel en 20021, à partir d’un large éventail de concepts mosériens (« traduction », « temporalité », « recyclage » ou « baroque »). Mieke Bal propose une interprétation politique du film (et de son installation), à la lumière d’une production ultérieure de l’artiste (Where is Where?, 2008), selon un processus de « rétro-prospective » cher à Moser (27 et 39). Bal montre comment le procédé cinématographique du plan rapproché sur le visage neutre de l’héroïne, une jeune schizophrène, concourt à faire d’un affect un medium, et rend le propos d’Ahtila politique. La « schizophrénie » du cinéma et de ses effets devient une « “transposition” naturalisante de la schizophrénie sociale que produit l’individualisme dans l’Occident capitaliste » (32). La rupture de l’espace-temps impliqué par la maladie oblige à une instantanéité permanente, que Bal conçoit comme une « interpellation philosophique du déterminisme de l’histoire conçue comme chronologique et évolutive » (34). L’affaissement des frontières du moi dans la psychose individuelle forme un écho, subliminal dans toute l’œuvre de la cinéaste, à l’accueil des réfugiés et à la rupture des frontières entre moi et l’autre dans la psychose sociale. Par le travail du son, par l’affect et par les effets d’images anachroniques (les bateaux à aubes), Ahtila offre une histoire proprement « baroque », non linéaire et hétérogène qui affronte l’amnésie ou la bonne conscience politique actuelle, et s’ouvre à une perception « étendue » de l’espace hospitalier, vision alternative rafraîchissante en réponse au repli des politiques gouvernementales modernes en Europe.
Dans « Voyage transculturel », Zilá Bernd considère l’anthropophagie dans les cultures d’Amérique du Sud selon une « perspective comparée transaméricaine » inspirée des idées de « recyclage naturel » et de « mobilité culturelle » développée au Nord. L’auteur insiste d’abord sur la symétrie et la bilatéralité des échanges intellectuels entre le Brésil et le Québec depuis les années 1980, dont elle retient quelques aspects importants pour le développement de chaque culture. Une des principaux apports conceptuels du Sud au Nord touche à la question identitaire. « L’anthropophagie culturelle » d’Oswaldo de Andrade (1928), acte provocateur de dévoration de la culture de l’autre, « assimile » sans possibilité d’oubli ce « confluent d’hétérogénéités que nous sommes » (Moser, 1992, p. 150), sans substance identitaire préétablie, sans priorités métaphysiques ni déterminations biologiques, tandis que la culture québécoise s’affirmait dans la lutte contre l’anthropophagie des cultures française puis anglaise, mais l’ironie du concept permet d’approcher aussi les thèmes structurels de sa littérature (État-nation, identité ethnique et culturelle, immigration et autochtonie). Le concept de « transculturation », qui semble mieux exprimer les échanges entre les cultures en Amérique aujourd’hui que des mots comme inter- ou multiculturel, synthétise deux idées mosériennes : celles de transfert matériel (les obélisques d’Assouan que l’on retrouve tels quels à Paris, Rome, Londres…) et de transfert conceptuel, qui implique une transformation et une subversion de l’objet transféré (par exemple, le Broken Obelisk de Barnett Newmann).
Le « recyclage culturel » peut quant à lui être compris sous quatre angles : comme modification d’un objet artistique au sein d’un circuit commercial ; comme reproduction industrielle des objets d’art ; comme technologisation de ses moyens de reproduction ; dans le cadre de la mondialisation après les indépendances. Bernd explique le succès de ces notions en Amérique par la relativisation des « théories européennes hégémoniques » et le « décentrage salutaire vis-à-vis du comparatisme traditionnel » (49) qu’elles exercent : elles permettent un échange « sur un pied d’égalité » entre deux cultures, où l’autre et soi-même sont vus sous un nouvel angle, ni supérieur ni subalterne.
Régine Robin reprend, avec « Pourquoi chercher Beverly Hills à Beverly Hills », sa réflexion sur la « ville fantasmée à l’écran » (51) publiée en 2009 dans Mégapolis (Robin, 2009). En visitant la ville, le promeneur se fait une « fête » de reconnaître des « morceaux d’images » du lieu vus dans les films, au cours d’un processus de « recyclage » personnel du décor, du faux, de l’imaginaire, où le sujet abandonne toute notion d’authenticité et de « non-lieu » au profit d’un remodelage subjectif de la ville originale et de sa copie cinématographique. Robin insiste sur l’importance que prend à ses yeux le caractère factuel de ce recyclage urbain, quitte à en perdre la spontanéité de la découverte du lieu : quand on ne reconnaît pas la ville de ses rêves, on l’apprécie moins. Le vieux Paris, le vieux Shangai, Venise ou New-York ont finalement plus de réalité dans l’imaginaire. Sa réflexion/rêverie poétique mène des villes réelles devenues fantasmées aux « cities from zero » (Shuman Basar), parties de rien, d’un rêve de ville, et bâties en un clin d’œil : Dubaï, ville où tout est neuf – même le vieux, reconstitué à partir d’un fantasme de passé ou de programme touristique, ville tournée vers l’avenir et le brassage des cultures, forme ainsi un amalgame étrange d’original, de copie et de simulacre.
Gastón Lillo clôture la première partie avec un article sur « Mémoire et oubli dans La Teta asustada de Claudia Llosa ». Rappelant le besoin actuel des pays latino-américains de « recouvrement de leur mémoire » après les massacres des dictatures, Lillo applique le concept mosérien de mémoire/oubli et de transfert culturel à un film péruvien de 2009, La Teta asustada2. L’oubli est nécessaire et positif dans le cadre des transferts culturels, comme l’a souligné Moser : le « moment de perte de valeur et d’oubli est […] la condition pour une revalorisation et pour la construction d’une nouvelle mémoire culturelle » (Moser, 2000, p. 42). Cette conception s’oppose au « devoir de mémoire » contemporain, voire au « culte mémoriel » (Bédarida, 1998, p. 89) que l’on impose à la conscience collective, et surtout à une définition binaire et négative de l’oubli comme perte ou négation de mémoire, qui permet l’intégration du passé dans un avenir heureux, débarrassé des traumatismes. Dans La Teta asustada, la guérison d’une jeune femme quechua, traumatisée par le viol de sa mère alors enceinte d’elle, constitue une « apologie des effets bénéfiques de l’oubli » pour des générations de Péruviens entre 1980 et 1992 (77). La jeune femme se délivre de sa peur maladive des hommes à travers la mise en valeur d’une mémoire culturelle et la réaffirmation identitaire du chant et de la langue maternelle, en opposition à une logique marchande capitaliste qui fait oublier l’ancrage originel des choses au profit de leur circulation. Cependant, le film ne propose pas de lecture historique ou politique, ni n’exploite la complexité du passé personnel de la jeune fille, sa peur ou sa colère. On assisterait plutôt ici, dit Lillo, à une « anagnorèse fortuite » (84), le souvenir étant neutralisé chez la protagoniste par du « faire mémoire » qui la préserve des dommages identitaires et intègre son passé conflictuel dans le récit de l’identité collective.
Ces quatre premiers articles illustrent combien les questions identitaires personnelle et collective sont intimement liées dans les productions modernes, que ce soit au cinéma, dans la littérature ou les autres arts. La richesse du concept de « recyclage » et de « transfert culturel » permet cette approche synthétique du soi et de l’autre, de la subjectivité et de la collectivité appréhendées comme un seul affect.
« Postromantisme, baroque et Spätzeit »
Avec la deuxième série d’articles, nous abordons le problème du baroque et des frontières spatio-temporelles.
Timothy Reiss propose en introduction à cette partie un panorama des « histoires et géographies du baroque américain » du Sud qui s’étend du Mexique aux Antilles. Au XVIIe siècle, le courant littéraire baroque est considéré comme décadent par une génération exaltant l’épopée des conquêtes (Picón-Salas, Leonard), ou comme un moyen de promotion de la colonisation par une monarchie en crise d’unité culturelle, politique et économique (Acosta, Maravall). Reiss se penche sur les conceptions de deux historiens mexicains représentatifs du courant du « barroco de Indias », Sigüenza et Balbuena. Sigüenza écrit l’histoire pour guider et juger les actions du peuple en leur fournissant des exemples universels plus que particuliers, à l’image du théâtre, le genre baroque par excellence. Écriture baroque révolutionnaire, qui produisit une nouvelle culture à partir d’histoires et de géographies locales, le projet de Sigüenza ne se résume pas à un style, à une narration ou une rhétorique, mais forme un « processus » de « mise ensemble d’une diversité de sources » (102). Balbuena porta plus loin cette nouvelle écriture en reprenant des fragments de grands poètes latins, italiens ou des Pères de l’Église pour composer La grandeza mexicana(1604). Les souvenirs des grandes villes européennes servent ici à créer une nouvelle grande ville mexicaine, quitte à passer sous silence les histoires et les géographies indigènes, ensevelies sous une énumération de richesses minérales, commerciales et naturelles des quatre coins du monde. Entrepôt mondial, le prestige de la nouvelle ville tient à son exploitation des ruines d’un passé perdu, qui lui insuffle sa force en l’élevant au niveau des grands empires, anciens et contemporains, tout en incorporant et prolongeant son passé aztèque. En situant la ville mexicaine au cœur des multiples histoires qu’elle mène à leur apogée, Balbuena crée un « nouveau sens de l’histoire » (110). Aux Antilles également, la géographie se substitue à l’histoire pour célébrer une culture en évolution. Sylvestre de Balboa (1560-c.1620), dans son poème Espejo de paciencia, énumère la faune et la flore locales et les dons de chaque peuple du lieu (Noirs, Indiens, Créoles d’Amériques, colons européens), créant une « poésie d’un lieu différent » qui donne un sentiment profond d’appartenance au peuple qui y vit par « l’invention de culture dans un lieu où l’histoire européenne ne constitue plus qu’un fragment d’un ensemble, une bribe à relier à d’autres bribes, d’une manière dictée par le souvenir des topographies locales » (117). Chez les trois historiens, on remarque donc une volonté de « renversement » des récits européens pour s’abreuver à d’autres sources, « selon des contextes et des impératifs locaux », conclut Reiss (117).
Karlheinz Barck étudie quant à lui le « baroque de la banalité », notion utilisée par Walter Benjamin pour distinguer son travail de traducteur du classicisme allemand ou Jugendstil associé notamment à Stefan George. La traduction « baroque » de Benjamin cherche « une orientation nouvelle dans des terrains vagues » (124) qui fait sortir le baroque du seul domaine de l’art et lui permet d’en étendre la définition. En confrontant deux traductions, par George et Benjamin, du même poème de Baudelaire, « À une passante », tiré des Fleurs du mal, Barck montre sur quel principe opposé les deux textes se fondent : pour George, la traduction semble liée au temps qui passe, et nécessite sans cesse de nouvelles adaptations au fil des époques, des modes, des styles, tandis que pour Benjamin, la « re-traduction » est liée à un lieu, celui de la poésie, donc à l’évolution des langues (130). Autrement dit, la traduction pour Benjamin n’est plus une adaptation à la mode, mais une véritable recherche poétique, dans les pas de l’auteur traduit, au plus près de lui au moins.
François Lucbert propose une analyse d’Athanor, la grande peinture murale flanquée de deux sculptures de Danaé et de Hortus Conclusus, offerte par Anselm Kiefer au Louvre en octobre 2007. Cette œuvre permet de discuter de la tradition quelque peu oubliée du grand musée de donner un espace d’exposition ou de création à des artistes vivants. Lucbert souligne d’abord la grande unité du lieu : l’œuvre de Kiefer s’intègre parfaitement dans un décor laissé longtemps inachevé, dans l’escalier qui mène au parcours des Antiquités égyptiennes. Aussi l’artiste a-t-il travaillé spécialement le thème des frontières, dans une dimension philosophique (un homme nu git étendu, son cordon ombilical dressé vers le ciel, comme suspendu entre la vie et la mort), mais aussi dans le jeu avec l’histoire de l’art (rappel des gisants du Moyen-âge, art contemporain, sculptures romaines). L’œuvre est une réflexion sur la condition de l’artiste, qui apparaît en autoportrait, et sur son art, comparé ici à celui de l’alchimiste (gradations dans la toile vers l’or). Mais la toile fait aussi constamment référence à la littérature, à la mythologie d’Ovide, ou encore à Paul Celan : Danaé, la fleur qui se déploie comme l’imagination, n’est pas représentée dans une perspective érotique, mais plutôt symbolique et poétique, qui contribue à la forte « charge mémorielle » de l’œuvre entière (139), hantée par les « aléas de l’histoire » et la « géniale vanité de l’aventure humaine » (140).
Enfin, Richard Bégin propose une définition du genre apocalyptique au cinéma en le confrontant au concept de Spätzeit. Le film post-apocalyptique est un mélange de genres, mais il répond toutefois à une double convention : perdu dans les décombres d’une civilisation, le héros doit survivre à et dans cet « après-coup » (140). Une vie est toujours possible dans l’après, dans l’attente de la fin absolue. Bégin analyse quelques films comme The Last Man on Earth d’U. Ragona (1964), 28 Days Later de Danny Boyle (2002) ou I am a Legend de Francis Laurence (2007). Dans tous ces films, le héros est considéré par les survivants comme une légende qui personnifie un paradis perdu (donc dangereux) et incarne une modernité passée, dégradée, à bout de souffle, qu’évoque le terme Spätzeit. Ce concept permet ici une analyse figurale de notre affect moderne, dont les symptômes sont, d’après Moser, « la perte d’énergie, la diminution de taille, l’épuisement de l’élan créateur » (145). Pour Bégin, la Spätzeit évoque davantage une « stase temporelle », un « lieu saturé de temps », une « décadence figurale du présent » plus qu’une « simple représentation de l’après », figurée au cinéma par une mise en scène de l’évacuation, de l’errance et de la dépression (146-47). Bref, elle permet une « approche heuristique inédite de la contemporanéité en elle-même » (148), si le contemporain est une « fétichisation de ce qui perdure ici et maintenant », et la survivance une « valorisation tardive d’une représentation qui n’est plus un espace, morceau ou cliché » (p. 148).
Cette dernière réflexion sur le temps et les valeurs des civilisations mène logiquement à une troisième partie plus philosophique, où sont discutées différentes valeurs issues de (ou fortement remises en cause par) la modernité.
« Esthétique et herméneutique »
Éric Méchoulan explore la culture de la valeur chez deux penseurs modernes de l’économie et de l’esthétique, Kant et Schiller. En partant de la notion de « désintérêt », qui « retraduit [aujourd’hui] dans le vocabulaire d’une économie politique moderne le style du loisir mondain et de la grâce sociale » (152), Méchoulan distingue chez Kant l’acception de « civilisation », « vernis de bonnes manières posé sur le travail secret de la moralisation intérieure », de celle de « culture », qui appelle « un travail interne de chacun dans le travail général de la communauté » (154). Autrement dit, la civilisation affiche (et se porte garant) de ce que la culture construit en chacun. La culture sauve les hommes d’une civilisation qui se construit laborieusement, sur une paradoxale « insociable insociabilité » (156), qui les pousse à vivre ensemble et à lutter entre eux pour trouver une place. La culture est donc « cette disposition acquise des êtres à produire de la valeur par l’antagonisme constant qui les anime » (156). Kant décrit ainsi comment naissent les valeurs dans le monde social après 1789, « dans la communicabilité des voix » (157) : la valeur d’un objet n’est pas dans son usage ou dans l’échange, mais dans le sentiment qu’on met en lui et qui peut être échangé. C’est à partir de cette conception de la valeur qu’il peut distinguer au niveau esthétique le beau (dont le pendant économique serait le désintérêt), le sublime (qui peut s’avérer contre l’intérêt) et le jugement réfléchissant, qui implique un sens de la communauté. Méchoulan s’applique ensuite à rapprocher le parallèle entre civilisation et culture kantienne de la grâce et la dignité chez Schiller. La grâce est une liberté de mouvement dépendante de la volonté, tandis que la dignité est au contraire une maîtrise des mouvements indépendants de la volonté. Chez Schiller, l’enjeu politique et social est donc plus ouvert que chez Kant selon Méchoulan, car grâce, « où la nature qui se moule à ce qu’exige l’esprit prend une apparence de liberté » (167), et souveraineté de l’esprit sur la nature sont affirmées. Ainsi, pour Schiller, la culture forme un « art des situations esthétiques », et non un travail sur soi en vue d’une vie sociale. À travers sa Bildung, sa formation culturelle, l’homme cherche à atteindre un « état esthétique » qui rende simplement possible le sentiment ou la morale tout en étant en-deçà, un état « fondamental et vide, immédiatement social et socialement sans contenu » (170). Ainsi, plaisir, valeur, autonomie et jeu reposent pour les penseurs allemands de la modernité sur un ordre de la production, mais seule la culture permet à l’homme « d’intérioriser la sociabilité », formée par le besoin et bâtie par la raison, et de « faire de l’intersubjectif la constitution de sa propre subjectivité » (172).
John Neubauer se penche quant à lui sur la complexité comme valeur esthétique et trait de société valorisé aujourd’hui, à travers une double approche : littéraire (« complexité érudite » des grands romans modernes et « complexité narrative » des romans plus récents) et sociale, dans le conflit entre « complexité théorique et revalorisation de la culture populaire » (173). La première partie de l’article rappelle la croissante complexité de tous les domaines de la pensée moderne, littérature, mais aussi théorie scientifique, musique dodécaphonique, art cubiste, etc., complexité dont le commentaire, nécessaire pour comprendre le réseau serré des allusions, sens et métaphores, contribue à en ajouter davantage. La lecture moderne, affirme Neubauer, bien loin de combler les « vides » du texte, crée de nouveaux trous, indéfiniment. Dans un deuxième temps, il montre que la complexité du roman actuel, dans son mode de narration comme dans le « retour à l’intrigue », est marquée notamment par une ligne temporelle problématique et un habile masquage de la voix narrative. Des romans-palimpsestes comme ceux de l’écrivain hongrois Peter Esterházy (Le livre de Hrabal, 1990, ou Harmonia cœlestis, 2000), qui appellent à une relecture pour élucider l’histoire à la lumière de ce qu’on apprend au cours de la première lecture, sont emblématiques d’un nouveau type de complexité plus « existentielle » (182), capable d’être comprise par un lecteur moins cultivé. Cette complexité s’observe non plus dès lors avec l’œil du spécialiste, « braqué sur le passé culturel », mais avec « un œil sur l’avenir » (183). Ce conflit entre critique moderne et critique contemporaine est approfondi dans la troisième partie de l’article, qui revient sur l’approche critique de Paul de Man, à laquelle l’auteur s’oppose encore aujourd’hui. Pour de Man, l’enseignement et la recherche ne doivent pas s’associer à une quête de vérité personnelle mais à une « méthode de lecture et d’interprétation presque scientifique » (184) qui évite tout affect et toute performativité de l’enseignement, dans la lignée humaniste du triviuum, fondé sur la rhétorique et la grammaire ; il souhaite « résist[er] à la théorie » dans la littérature, et même éliminer les théories concurrentes qui sont non des alternatives mais des erreurs. Son exigence va jusqu’à refuser de prêter main forte au lecteur dans son abord du texte, allant à l’encontre de la tendance de la recherche et de l’enseignement aujourd’hui, qui met justement l’accent sur le récepteur. Neubauer défend cette position dans cet article polémique (qui reste très respectueux du travail de son confrère) : « Quoi qu’en ait pensé de Man, aucun sujet n’est foncièrement trivial ; tout se situe dans la manière de le traiter », conclut-il (192).
Gille Dupuis ouvre le débat herméneutique au style en général en posant la question : « que peut faire le style ? » (193). Il développe trois réponses principales. Le style fait d’abord une « différence », vue comme une « altérité irréductible en tant que singularité à l’œuvre » (194), qui échappe à la tendance mais se constitue comme valeur heuristique, indice, vecteur, sinon producteur ou porteur de sens « ex nihilo », au sens lacanien. Il ne peut se démontrer mais se reconnaître, selon « d’infimes nuances par rapport à du déjà donné » (196). Dupuis illustre son propos de quelques exemples tirés de la littérature et de la musique. À ce titre, l’euphonie ou « l’eusémie » (199) sont une « économie stylistique » du sens où l’acoustique se lie à la sémantique pour « faire sens autrement », dans une « opération herméneutique » dont le style est le témoin privilégié. Avec Schönberg, Debussy, Barthes, Quignard, Lacan, le lecteur doit se tenir à « l’écoute de l’insignifiant » (208). C’est ainsi que Dupuis associe enfin le style à la Spätzeit, qu’il propose de traduire par « late style », cette façon d’être « intensément de son temps tout en ne s’engageant pas dans la voie indiquée par lui » (213), tel que l’illustre le Leverkühn de Mann ou la musique de Gould. Le style, d’après Dupuis, « retarde sur son époque, comme une sentinelle qui avance dans le temps tout en gardant un œil braqué sur le rétroviseur de l’histoire » (213).
Pour achever cette troisième partie, Philippe Despoix propose l’étude des « styles » de « portraits urbains » de la fin des années 1920, brossés au cinéma ou dans le roman. Genre cinématographique à la croisée du documentaire et de la composition filmique par le cadrage et le montage, le portrait urbain retranscrivait de façon purement visuelle les rythmes de la grande ville moderne, son anonymat, son extériorité, sur une unité narrative d’un jour, ce qui a permis de dégager l’autonomie d’un « langage » filmique propre, qui se distinguât de celui de la littérature. On retrouve ce procédé de « film en coupe transversale » (Querschnittfilm) dans K 13 513d du réalisateur Balázs, où l’on suit les déplacements d’un billet de banque à travers divers types de lieux sociaux. L’expérience visuelle qui en résulte, ainsi que l’effet d’abstraction de l’argent conviennent parfaitement au langage cinématographique, mais Balázs a dû céder à la narration d’une histoire d’amour imposée par le producteur, et ne peut éviter les effets d’anthropomorphisme du billet. Déjà Cavalcanti, dans Rien que les heures (1926), montre un Paris des marges de l’industrialisation, de la déchéance et de la violence sociale, à travers le destin de trois femmes, et par une suite d’images qui fonctionnent selon un principe « d’association poétique » (220). Walter Ruttmann avec Berlin(1927), Kaufmann avec Moscou, ou encore Vertov avec L’Homme à la caméra (1929), ou Jean Vigo dans À propos de Nice(1930), accentuent l’abstraction des images, qui se répondent d’une analogie formelle et subjective à l’autre, par le mouvement, la musique, la simultanéité, la matière, créant ainsi un « inconscient optique » de la ville, sans causalité ni objectivité formelle, qui commande aussi au montage du film. Ainsi naît à la fin des années 20 une conception artistique « formelle » ou « matérielle » (225) du cinéma qui redéfinit l’art, à moins qu’elle ne fasse changer la fonction de l’art. Despoix rapproche dans un deuxième temps le déplacement du cinéma vers le documentaire de celui du roman vers l’essai à cette même époque. Musil, dès l’introduction de L’Homme sans qualités, applique la technique de la « coupe transversale » cinématographique, en nommant les qualités abstraites visibles ou sonores des objets, qui forment un langage quasi conceptuel de « rythme multiple de la ville », symbole du « chaos spirituel d’une modernité sans autres formules sûres que la statistique » (228). L’interruption liminaire du trafic est le « paradigme d’un mode d’écriture essayiste », qui parodie le procédé cinématographique, conclut Despoix.
« Philosophie et littérature comparée »
La dernière partie du recueil regroupe quatre essais plus hétéroclites quant à leur propos, mais qui tendent à prouver, si le lecteur n’en était pas encore convaincu, la vaste portée des concepts travaillés par Walter Moser.
Marc Angenot aborde un autre type de « recyclage », celui du « fait religieux dans la modernité politique » (233) dans « Gnose, millénarisme et idéologies modernes ». Il passe en revue les diverses théories sur les « religions politiques » (Eric Voegelin) des idéologies de masse, qui seraient dérivées et déformées à partir des vues sociales et historiques des religions primo-chrétiennes (gnosticisme, culte du Soleil égyptien). Nombre de ces thèses « généalogiques » sur la modernité post-religieuse à l’œuvre dans les régimes totalitaires s’articulent autour de la notion de sécularisation de symboles et d’expériences religieuses anciennes sous une forme politique (Carl Schmitt, Karl Löwith), de réenchantement de l’histoire et de sacralisation du politique. Ainsi, la modernité ne serait pas en rupture avec le religieux, mais dans une « persistance dégradée » (247). Angenot s’applique à démonter ces thèses qui réduisent à son avis trop vite les fascismes à des religions politiques. Il rejoint Marx en affirmant que la modernité de ces régimes se construit à travers leur propre légitimation, par la réhabilitation de la « curiosité » théorique (255), qui « ouvre à une conception ontologique-substantielle de l’histoire des idées » (256) et oblitère la logique fidéiste au point de rendre illisible son texte religieux sous-jacent. La légitimation est dans ce cas « immanente au monde », ce qui s’oppose (et semble préférable) à la révélation d’un monde inconnaissable, imprévisible et indiscutable ; les régimes totalitaires s’appuieraient donc sur le rejet de toute révélation qui impliquerait un domaine échappant à la connaissance et à la science.
Revenant à la littérature québécoise, Peter Klaus montre comment le problème de la langue et la littérature sont perçus au Québec comme des « marqueurs identitaires », ce qui entraîne la politisation de toute question linguistique dans la province, mais aussi une « surconscience » de la survivance et/ou de la disparition des langues qui domine actuellement le discours officiel (259). Il distingue trois phases représentatives de cet état dans la production littéraire, des années 1960-70 au début des années 2000. La violence du conflit entre l’anglais et le français pendant la Révolution tranquille est sensible dans la littérature, que ce malaise passe par l’idée de « vécriture » de Jacques Godbout (dans D’amour P. Q. (1972) ou Salut Galarneau !), ou par l’affirmation libératrice du joual, la langue du « monde cheap », chez Michel Tremblay ou Jacques Renaud. Après le référendum de 1980, le débat s’apaise et est marqué par un effacement du « nous » au profit du « je » dans l’écriture, associé à l’ouverture générale des frontières du Canada, à l’accueil d’écritures migrantes allophones (Marco Micone, Gens du silence, 1982, une pièce sur les difficultés des immigrés entre deux langues et cultures), et à la découverte de l’américanité (Jacques Poulin, Volkswagen Blues, 1984 ; J. Godbout, Une histoire américaine, 1986) et de la francité des premiers explorateurs. Enfin, cette ouverture s’épanouit dans la « transculture » à la fin des années 1990 : la littérature québécoise s’est transformée au contact des imaginaires étrangers (La Québécoite de Régine Robin, Maryse de Francine Noël). L’écriture féminine tient un rôle important dans ce décloisonnement et dans sa capacité de transgression (Putain de Nelly Arcan, 2001). Le rapport des auteurs à la langue française s’en trouve décomplexé, et ceux-ci s’autorisent un recours plus courant à l’anglais, signe d’une libération linguistique, créative et symbolique.
L’article de Wladimir Krysinski retrouve une approche plus philosophique pour s’intéresser aux « fragments et fragmentaires dans la négativité chez Adorno » (273). Le fragment s’oppose naturellement à la décomposition, car il forme un « noyau de résistance dans le travail de sape permanent qu’a effectué l’histoire » (276). Krysinski part de l’analyse du discours de la négativité et du fragment chez Adorno pour revenir à l’écriture prismatique du philosophe, « saisie fragmentaire de l’objet représenté comme image de la pensée » (284), et à sa conception de l’essai en aphorismes (Minima Moralia), qui permet d’exprimer la « négativité comprise comme des moments constamment antithétiques de la pensée » (286). Adorno représente donc un courant théorique de la modernité opposé à la répétitivité produite par l’industrie culturelle (287), qui inscrit la théorie elle-même dans une perspective d’inachèvement et d’ouverture structurelle (290), ou encore de négativité et d’utopie (293), qui démultiplie les références. Bref, la pensée fragmentaire d’Adorno est une « pensée sans qualités », qui n’est pas sans conséquences pour le langage du philosophe : le fragment marque en effet l’irruption de l’immédiateté de l’histoire dans la pensée ; il s’oppose à l’idéologie identitaire et rend ambigu le statut du philosophe lui-même, puisqu’il opère une critique fondamentale du langage.
Les dernières pages du collectif produisent une traduction inédite d’un article paru en anglais du professeur et ami de Moser, Bill Readings, décédé en 1994. « Translatio et littérature comparée : la terreur de l’humanisme européen » affirme le triomphe de la conception moderne de la littérature comparée considérée non plus comme supranationale et européo-centrée mais comme une littérature des minorités et du dépassement d’une pensée « majoritaire », par essence intraduisible (la traduction des concepts philosophiques, sociaux, littéraires de l’Occident à l’Orient faisant partie d’une « mythologie blanche » (300) maintenant révolue) puisque les non-Occidentaux n’ont pas forcément de volonté d’accéder à leur « majorité ». Fondée sur une idée d’humanisme aujourd’hui dépassée, la discipline comparative se heurte à l’impossibilité de traduire l’ensemble de la littérature européenne, face à la résistance des corps qui grève l’abstraction de la pensée (Derrida, Alan Bass, Barthes). Il serait préférable, propose Readings, de parler de « littératures qui diffèrent » (305) pour cerner au mieux la réalité du comparatisme moderne qui conçoit une résistance du langage lors d’un « temps intraduisible », en opposition à la « traduction » capitaliste des échanges et du temps abstrait qui fonde l’hégémonie du genre économique (Lyotard). En effet, la difficulté d’écrire et de lire après Auschwitz et la terreur de l’unité européenne incite à trouver une « éthique de la lecture » (307) qui « dénationalise » les littératures, en abolissant non leurs différences mais « le mythe de l’identité que la différence régulée et policée maintient en place » (308). Readings invite ultimement à une « lecture des frontières et des limites territoriales » qui « débusqu[e] le mineur et invoqu[e] sa différence là-même où l’on ne s’y attend pas », appel enthousiaste à l’avènement d’un projet comparatiste.
L’ouvrage donne enfin une bibliographie exhaustive des publications de Walter Moser de 1972 à 2011.
Notes
[1] Eija-Liisa Ahtila, Talo (La maison), installation DVD 3 écrans, 16/9, v.o. en finnois, 14 minutes, 2002.
[2] Claudia Llosa (réalisation), La teta asustada, Institut Català de les Indústries Culturals / ICAA / Oberón Cinematográfica / TV3 / TVE / Vela Producciones / Wanda Visión S. A., Pérou et Espagne, 2009, 95 min.
Bibliographie
– Bédarida, François, « Mémoire et conscience historique dans la France contemporaine », dans Martine Verlhac, Histoire et mémoire, Grenoble, Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de Grenoble, 1998, 99 p.
– Moser, Walter, « L’anthropophagie du Sud au Nord », dans Zila Bernd et Michel Peterson, Possibilités de recherche comparatiste entre le Brésil et le Québec, Montréal, Balzac, 1992, p. 113-151.
– Moser, Walter, « La toupie « mémoire-oubli » et le recyclage des matériaux baroques », dans Marie-Pascale Huglo, Éric Méchoulan et Walter Moser, Passions du passé. Recyclage de la mémoire et usages de l’oubli, Paris et Montréal, L’Harmattan, 2000, 344 p.
– Robin, Régine, Mégapolis. Les derniers pas du flâneur, Paris, Stock, 2009, 397 p.
