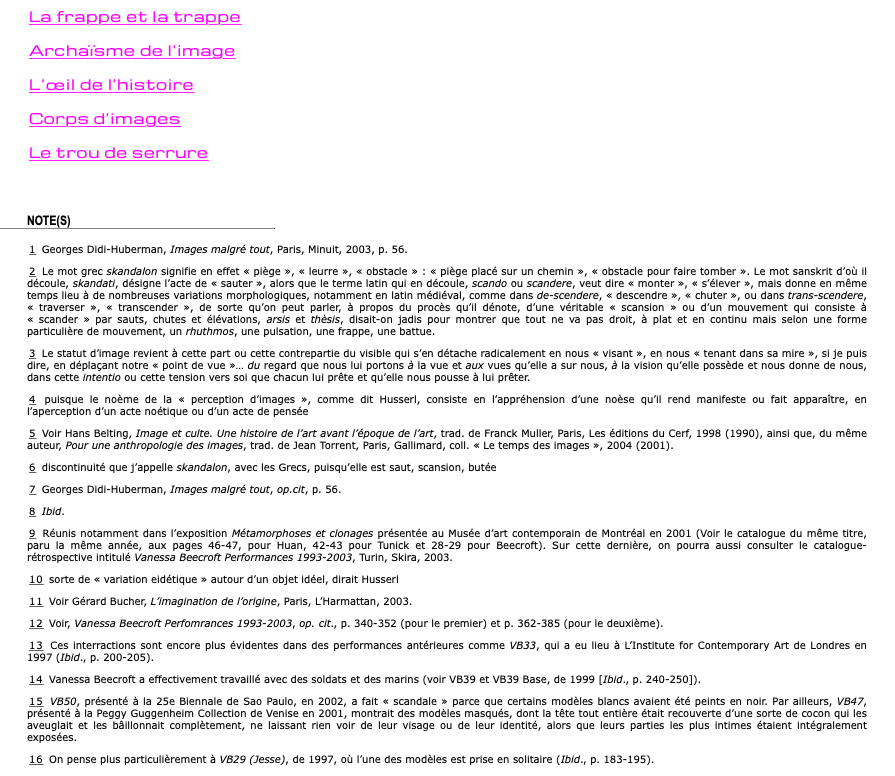Les images existent malgré tout, comme l’écrit Georges Didi-Huberman1. J’ajouterais quant à moi : malgré elles, malgré nous. Malgré le fait qu’on veuille qu’elles n’existent pas, parfois. Malgré le fait, aussi, qu’elles ont du mal à exister, souvent. Et pas seulement celles d’Auschwitz, d’Hiroshima, de la Kolyma. Les plus horribles, les plus terribles. Toute image, en fait. Dès lors qu’elle ne passe pas inaperçue, qu’elle « frappe » littéralement les sens et la conscience… et que cette frappe la marque en tant qu’« image » — les Grecs désignent souvent celle-ci par le terme tupos plutôt qu’eikôn : « marque imprimée par un coup », non seulement dans la matière sensible, comme l’« empreinte » ou le « sceau » ou même la « blessure » (que désigne également l’étymon du mot type), mais dans l’esprit aussi, mémoire et imagination comprises, comme toute « représentation » qui est toujours une « im-pression », une « pression sur et dans » la substance propre à la conscience. Toute image frappe, donc… malgré tout, malgré elle, malgré nous.
Toute image, typique ou atypique, scandalise au sens fort de l’expression : elle « piège » la vue, capte, capture, viole la conscience, trouble l’esprit, nous fait émotivement monter, descendre, tomber ou nous emporter dans une sorte de lévitation ou de surcharge perceptive et affective, en changeant plus ou moins notre centre de gravité mentale, dérangeant notre équilibre ou notre stabilité psychique. Je parle par métaphores, bien sûr, pour décrire de manière hyperbolique, avec ses effets grossissants, l’événement cognitif singulier en quoi consiste ce qu’on appelle « conscience d’image », mais en me tenant au plus près du sens littéral de l’étymon du mot scandale lié depuis tout temps à celui d’image2.
Le scandale nous frappe, nous fait faire un saut ou un sursaut, par un brusque changement de rythmes, sans doute imprévisible, qui nous « piège » et nous fait tomber : une embûche ou un obstacle sur lequel on bute puis chute, prenant ainsi une embardée ou une envolée. Bref, le scandale introduit dans le cours des choses une discontinuité ou une rupture, qui « dérange », bien sûr, change l’allure ou l’allant du monde, fait obstacle à sa belle continuité ou à son continuum, « piège » l’être, lui tend une embuscade… pour qu’on voie qu’il ne tient pas droit, debout sur son socle, mais qu’il oscille, sursaute, tombe ou s’emporte, selon une scansion si vive et brusque qu’elle empêche toute station, de l’être. Le scandale, c’est l’« achoppement », comme dit le mot grec : la « pierre d’achoppement » sur le chemin du monde ou dans le cours des choses, sinon dans le flux de la perception ou de la conscience, qui produit ce qu’on appelle un « choc » — on est heurté, blessé peut-être, on est atteint dans son intégrité. On a fait un brusque saut, on a fait une sorte de chute, on a perdu pied, pris au piège d’une autre « scansion » que celle du cours normal des choses, qui se met d’un coup à « scander », à « scandaliser ».
Or, qu’est-ce qu’une image ? Qu’est-ce que la « conscience d’image », selon la phénoménologie husserlienne, notamment, qui nous permet de comprendre qu’on ne perçoit pas les images de la même façon que les choses, qu’on ne voit pas l’eikôn (l’image) comme le to on (l’être), l’icône en tant qu’étant ? Il y a une discontinuité fondamentale entre le tableau et le mur sur lequel il est accroché, entre la sculpture et l’espace meublé de différents objets où elle est installée : cette coupe, cette coupure, ce découpage n’est pas lié au cadre délimitant la toile ou au contour apparent de l’objet sculpté, comme l’art contemporain nous l’a maintes fois montré — des grands dessins couvrant les murs et les plafonds d’un Sol Lewitt aux tuiles de métal couvrant le sol d’un Carl André —, mais à un acte noétique ou acte de conscience, donc, qui rompt la continuité du visible par l’attribution d’une visée (ou d’une intentio) à l’image, c’est-à-dire de « vues » et de « visions » que le visible en général ne possède pas. Il y a dans toute image une « tension » vers quelque chose ou vers quelqu’un — un intendere ou acte de « tendre vers », littéralement — qui fait que la conscience du regardeur se sent aussitôt visée, captée, piégée par ce qu’elle nous donne à voir, par ce qu’elle nous fait sentir, dont le statut de pure donnée du monde visible se trouve dès lors remis en cause : nous ne sommes plus devant le monde, mais quelque chose, dans le monde, est devant nous, nous fait face, nous fait obstacle, nous regarde. Nous vise, nous cible, nous capte : on est piégé par quelque chose qui ne se contente pas d’être visible, qui est aussi « vision » et peut-être « visage », au sens levinassien du terme, ce qui explique notre grand respect devant les œuvres d’art ou les objets de culte (paradigmes ou hypostases de l’imago) comme devant les êtres humains3.
Ce qui nous choque, ce qui nous heurte soudain dans la belle continuité du visible, c’est que nous nous sentons visés dans notre intimité par ce drôle de visible que nous appelons image. Voilà le scandale, voilà où ça « achoppe » : le monde n’est pas uniformément donné dans la vision que j’en ai, qui lui confère son identité, son homogénéité, son unité ou sa mêmeté. Il y a des trous ou des solutions de continuité, des pièges et des obstacles dans le continuum du visible qui font que rien n’y est stable, moi-même ou ma conscience encore moins, qui peut à tout moment y subir un choc, un heurt, un saut, une chute, dans la mesure où elle est potentiellement visée, ciblée, touchée par cette part de visible dont relève l’imago (ou l’image), cette part qu’on peut dire « réversible » parce qu’elle nous vise davantage que nous ne la visons.