
1. Comment la numérisation a-t-elle contaminé votre pratique photographique?
La photographie numérique est venue réconcilier plusieurs aspects de ma pratique artistique. D’un côté, à la maison, il y avait les photos sur lesquelles j’intervenais en les découpant, les coloriant, en écrivant dessus, mais ces images étaient réservées au privé, à mes ami-es, comme une carte postale, une petite blague. De l’autre côté, dans les espaces publics, des photos sérieuses, voire arides, en tout cas correctement imprimées. Le numérique m’a permis à la fois d’intégrer ce côté ludique et spontané, tout en me permettant d’autres incursions beaucoup plus picturales, ce que je ne m’offrais pas avant, n’étant pas une plasticienne.
Dans le même ordre d’idées, voici ce que j’avais écrit en février dernier (1999) pour la chronique « Tête Branchée » du journal Voir:
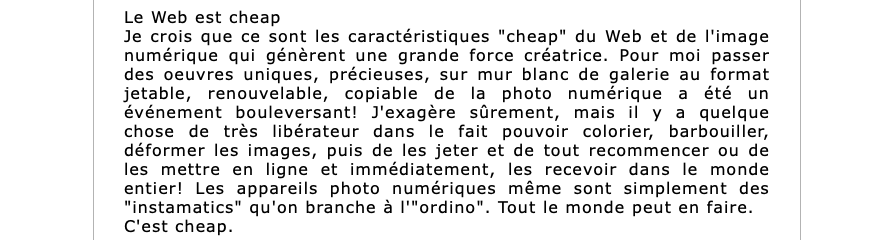
Je dirais aujourd’hui que la perte de l’unicité de l’oeuvre engendrée par le numérique stimule la création d’oeuvres beaucoup plus éclatées. Mais ceci n’est pas nouveau, puisque ce constat est arrivé avec l’ère de la reproduction et de la photographie!
2. La narration est-elle au centre de votre processus interactif et créateur?
J’ai toujours travaillé la photographie de façon narrative ou associative. Je ne produis jamais d’images seules, mais des séries, comme des mots qui ensemble forment des phrases. C’est le choix, la juxtaposition qui provoque un sens. Maintenant que je comprends beaucoup plus l’interactivité et le
Web, je replace la narrativité au centre, car cela me semble plus stimulant et complexe de « raconter » ou de mettre en scène des histoires qui peuvent être percées de toutes parts par des échappées, des hyperliens.
Mercredi au Media Lounge, après la projection, une amie vidéaste me disait qu’elle ne comprenait pas qu’avec un matériel aussi riche nous replacions le tout dans un contexte narratif, duquel tout le monde tente de s’affranchir… Peut-être que notre démarche va à l’envers des artistes de la vidéo et du cinéma habitués à travailler avec un scénario. Pour nous, avec Liquidation, c’était le défi principal, avant même que le produit, de livre, ne devienne un cédérom aléatoire. Nous n’avions jamais, ni lui ni moi, écrit une « vraie » histoire, un scénario qui prennent en compte surtout les structures et les conventions des genres populaires : roman policier, roman photo, etc. Aussi, nous nous sommes positionnés rapidement pour la primauté de l’histoire, parce que nous étions déçus des produits multimédias et interactifs que nous trouvions… beaucoup de clics, des images de synthèse, peu de contenu… C’était le cas, par exemple, en 1995, avec l’expo ISEA95… Ça a évolué depuis. En fait, on a commencé complètement à l’envers … Pendant un an nous avons mené une démarche exploratoire, Michel travaillant avec un logiciel de poésie aléatoire et moi photographiant des contextes beaucoup plus scénarisés ou « réalistes » autour de la liquidation et de son corollaire l’accumulation. Au bout d’un an, on a mis les photos d’un côté, le texte de l’autre, et ça n’allait pas du tout! En fait, ç’aurait pu devenir un livre poésie/photo, avec beaucoup moins de contraintes de sens, mais on voulait notre histoire!
3. Quelle place accordez-vous à l’humour dans vos projets?
Dans nos réalisations collectives (Michel et moi), il y a un parti pris assez clair pour l’humour, mais surtout pour un regard critique, ironique ou parodique sur notre milieu social et artistique. Notre première collaboration remonte à 1990, avec Portraits/Potins d’artistes, une exposition photographique et un texte radiophonique présentés à Montréal et à Mexico. Le texte, un peu absurde, est en fait un collage de propos enregistrés dans un souper, où les photos étaient exposées et où les convives étaient invités à « potiner »… Avec l’humour on garde aussi une distance, on peut dire des choses « importantes », des constats sociaux, sans trop se prendre au sérieux, sans le côté moralisateur ou documentaire…

