André Éric Létourneau : Quand j’observe tes œuvres sur ton site web je constate une transformation dans celles réalisées entre 1997 et aujourd’hui. J’ai l’impression qu’elles sont de plus en plus immersives. Pas dans le sens technologique du terme – bien que déjà Brainstorm de 2011 soit configuré comme un environnement immersif – mais dans le sens qu’on peut dire in socius. Par exemple, dans la dernière œuvre, Tourmente, qui comprend un écran dans l’espace public, un spectateur peut faire varier l’image à partir de son cellulaire. Cela produit un sens qui dépasse même la relation entre le téléphone, l’usager et l’image, mais englobe justement l’espace public dans lequel l’expérience est présentée. Dans ce sens-là c’est une œuvre vraiment immersive. Je trouve intéressant de voir cette progression parce qu’au départ avec Zones franches et Égographie, l’usager se trouvait dans un rapport tactile avec les écrans, et cela jusqu’à Les errances de l’écho en 2005, production dans laquelle tu utilisais un miroir interactif, un objet concret. Le son aussi évoque une forme d’immersion dans ton travail. Cette forme d’immersion se déploie dans le temps d’abord avec les écrans, les projections, puis l’effet d’immersion englobe l’environnement au complet à mesure, que l’œuvre se déploie dans l’espace public.
Jean Dubois: C’est bien observé, d’ailleurs je devrais mettre mon site web à jour pour y insérer mon projet de maitrise qui est à l’origine de ces productions. Mais j’y reviens avec des moyens technologiques différents. Au début, je n’avais pas les moyens, tant au niveau technologique que financier. L’œuvre que j’avais faite à l’époque était GODDOG, une série d’interventions in situ qui reprenaient le palindrome GOD/DOG et abordaient le rapport à l’espace public, c’est-à-dire la façon DOG de l’occuper par le graffiti et la façon GOD de le faire par la publicité. J’avais fait financer un panneau publicitaire qui annonçait GOD. En dessous, la nuit suivante, j’avais écrit clandestinement DOG avec une bombe aérosol. Je m’étais amusé à jouer avec les deux registres politiques du discours.
J’ai fait aussi une performance, dite immersive, dans une église médiévale à Maastricht. J’étais en stage à la Jan Van Eyck Academy. On m’avait invité à participer à une exposition de groupe avec tous les étudiants. Tout le monde s’était désisté à la dernière minute. Sans le savoir j’étais le seul qui travaillait toujours à ce projet. On m’a alors proposé de garder l’église pour moi tout seul.
Il a donc fallu que j’invente quelque chose rapidement. Remplir une église médiévale avec aucun budget, ce n’est pas évident. Nous avions accès à une imprimante lithographique. J’ai imprimé des affiches. J’ai utilisé des éléments décoratifs que je pouvais imprimer sur du papier journal. J’ai complètement redécoré l’église avec un motif reprenant confusément GOD et DOG. On ne savait pas s’il s’agissait de DIEU ou de CHIEN. Cette église médiévale était désacralisée. Elle servait d’espace pour des activités foraines. Il y avait des raves pour gais et lesbiennes, des expositions d’automobiles, la foire de Noël… Toutes sortes d’événements s’y produisaient. Pour moi, Nord-Américain, je trouvais cela complètement ahurissant. Je me disais : «Une église médiévale qui sert à faire n’importe quoi !» puis j’ai pensé : « En fait, elle est entre GOD et DOG. » J’ai donc commencé à en faire le lieu d’une performance où j’allais essayer d’allumer deux mille bougies pour remplir l’espace avant que la première bougie ne s’éteigne. En cas de réussite, je me proclamerais GOD. Si je ne réussissais pas, je resterais DOG. J’avais tout prévu pour échouer, naturellement. Cette performance avait eu un impact immersif pour certains qui m’ont dit « Depuis cette exposition, j’ai remarqué qu’au plafond, il y avait des fresques. En temps normal, à cause de l’éclairage naturel, on ne voit jamais vraiment bien le plafond. Cette nuit-là avec tes deux mille bougies qui éclairaient de manière uniforme le plafond, on pouvait voir des choses qu’on ne voyait pas auparavant. » Ce fut un accident intéressant. Les gens qui étaient dans l’église vivaient une expérience immersive. L’église prenait un autre aspect. Le lieu redevenait plus sacré grâce aux bougies et la performance semblait être celle d’un « l’artiste-prêtre ». Tout ça, en jouant avec une ambiguïté, en entrelaçant des mots pour créer une situation temporaire qui interrogeait à la fois le statut traditionnel de cette église et son nouveau statut de centre d’exposition et de centre communautaire, en fait d’espace à tout faire.
Enfin, pour le troisième volet, j’ai fabriqué des objets promotionnels que je mettais dans les boites aux lettres de 900 adresses de la rue Berri à Montréal. J’y avais mis des cartes postales, des échantillons de produits, des flyersGODDOG. J’y plaçais moi même les objets. Les gens m’arrêtaient dans la rue pour me poser des questions. « Ça fait trois jours que je reçois ces affichettes, qu’est-ce qui se passe ? » Je répondais : « Moi madame, je suis payé à l’unité, je ne fais que les donner » et je les laissais à eux-mêmes avec leurs interrogations. Sur les produits GODDOG, il y avait une adresse de case postale et certaines personnes ont réagi en répondant.
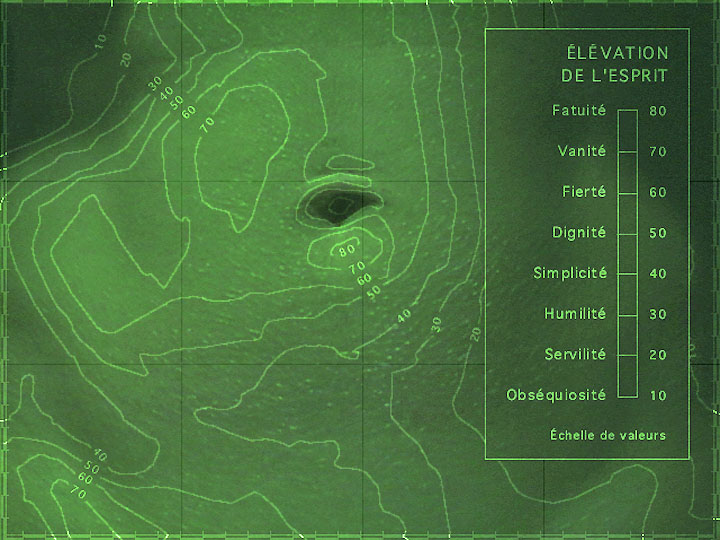
A. É. L. : Quel genre de commentaire recevais-tu ?
J. D. : Il y avait deux types de réactions : une réaction anglophone et une réaction francophone.
A. É. L. : Cela arrive parfois à Montréal !
J. D. : Il faut comprendre que les mots GOD et DOG en français, n’ont pas le même impact émotif qu’en français. Les anglophones réagissaient assez durement, pas au fait que cela touchait le mot GOD. Ils réagissaient plutôt au fait que les corporations hackaient leurs boites aux lettres. Ils réagissaient à l’infiltration totalitaire de la publicité dans leur maison comme si leur la boite aux lettres était l’orifice de leur intimité. Revenant aux notions d’intimité et d’espace public, on peut dire que la boite aux lettres se trouve au seuil de l’intimité (espace personnel) et de l’espace public, (la rue).
A. É. L. : C’était avant l’apparition des courriels et des polluriels.
J. D. : En effet. Mais c’est un peu la même chose quand j’utilise les panneaux publicitaires et les écrans lumineux urbains. Avec l’infiltration des boîtes aux lettres, je voulais croiser l’espace de l’intimité avec celui de l’espace public. Ouvrir un passage entre le sacré et le trivial.
A. É. L. : On se rapproche aussi du concept d’artiste entreprise de Iain Baxter.
J. D. : À l’époque c’était mon type de modèle : un artiste conceptuel qui reprend des moyens de production industriels et qui essaie de les déconstruire à travers des usages absurdes.
Lorsque j’ai commencé à travailler avec le numérique, il y avait tout à apprendre. Je voulais essayer d’appliquer la logique GODDOG aux écrans tactiles, ainsi les écrans devaient fonctionner comme de la peau. Ils pouvaient sentir qu’on les touchaient. Cela impliquait alors une nouvelle éthique. Avec Zones Franches, par exemple, on ne regarde pas seulement le corps nu de quelqu’un sur l’écran. On le touche et le corps réagit.
À l’époque, j’avais eu d’ailleurs des problèmes avec mes amies artistes féminines qui me disaient « Tu n’as pas le droit de travailler avec le corps féminin. » Je me suis rendu compte que le fait de toucher un corps féminin, de travailler avec un corps féminin avait un impact politique. Ce n’était pas juste une belle idée, évoquer la peau avec la surface de l’écran. Je me suis obstiné et je me suis dit : « Je vais le faire de façon à ce que vous ne puissiez pas me reprocher, par la suite, de l’avoir fait. » J’ai fait quelque chose d’assez, assez subtil, assez respectueux. C’est assez prude. Je ne voulais pas en faire quelque chose de pornographique ou quelque chose qui réifiait la femme, la voyant comme un territoire à occuper. C’étaient des questions qui étaient soulevées. Une fois l’oeuvre terminée, ce problème d’éthique a semblé s’estomper. Personne n’est revenu avec cette critique. À ce sujet il y eut encore un quiproquo anglais/français : On m’avait invité à faire partie d’une exposition féministe anglophone. Parce qu’on pensait que «Jean», Jean Dubois était une femme. On m’avait invité, car on avait perçu cette œuvre comme un travail féministe. Lorsque je me suis rendu à la rencontre avec les organisatrices, elles ont vu que j’étais un homme. Je leur ai dit « Ben, mon nom ce n’est pas Jean, c’est Jean. » Elles m’ont répondu : « Finalement, ça ne marche pas. Tu ne pourras pas être dans l’exposition. »
A. É. L. : La même œuvre n’avait plus le même sens.
J. D. : Je m’étais rendu compte que l’intentionnalité était perçue différemment. L’objet est le même, mais le discours différent, dépendant si l’auteur est un homme ou une femme. Mais finalement est-ce que l’objet est différent ?
A. É. L. : Comme par exemple, la lecture d’une œuvre change si on la place dans un musée ou au milieu de la rue Sainte-Catherine.
J. D. : Je dois dire que je me suis retrouvé dans la situation inverse à celle de George Sand. Quand je pense à cette œuvre, je pense à la notion de limite et cela me fait penser à d’autres œuvres : par exemple, au travail de Dominic Gagnon et de son film Of the North. S’il avait été fait par un Inuit, il aurait été perçu complètement différemment. Mais parce que le réalisateur est un blanc, le film a été perçu comme complètement condescendant et même méprisant. Mais si un Inuit l’avait réalisé. On aurait dit : « Il travaille pour sa société, pour montrer qu’il y a des problèmes sociaux et qu’il faut agir. »
A. É. L. : Oui et peut-être même que Tanya Tagaq lui aurait laissé les droits d’utiliser son chant du début du film ! En fait la polémique a commencé à propos de cela.
J. D. : Au début c’était un problème d’éthique artistique, la chanteuse lui a dit : «Tu as utilisé mon travail à tes propres fins». Et cela est devenu un problème d’éthique politique par la suite. Il y avait ainsi deux problèmes. Le numérique crée peut-être des ambiguïtés de ce genre. Les auteurs sont souvent absent du lieu de diffusion et donc plus distants. On ne les voit pas autant que, par exemple, en littérature où la photo de l’écrivain est présente. Dans le monde numérique, temps, on ne sait pas qui est vraiment l’artiste. Est-ce que c’est un blogueur ? Un journaliste ? Qui fait quoi ? Il y a beaucoup de substitutions d’identité. Il y a en plus des gens qui ont des identités multiples sur Internet. Je ne sais pas si cela est la cause, mais l’intentionnalité est vue différemment. Il peut y avoir des incompréhensions car parfois on sait pas à qui on s’adresse. Surtout dans un Internet globalisé où les langages étrangers ne donnent pas d’indices sur la nature des références culturelles. Par exemple, en lisant un nom de famille en Inde, je ne sais pas de quelle caste il provient. Est-ce que c’est un homme ou une femme ? De quelle région vient-il ? Je n’en ai aucune d’idée : c’est un nom, une forme. Cela peut créer des quiproquos au sujet de l’intentionnalité. Le filtre du numérique peut permettre ce genre de distance qui crée un flou, comme c’est arrivé pour moi avec mon prénom Jean qui a été interprété comme Jean prénom féminin en anglais, dans le cas d’une exposition exclusivement faite par des femmes.
A. É. L. : Le cadre est très déterminant dans la lecture de l’œuvre. Plusieurs artistes, dont le plus célèbre est sans doute Duchamp, l’ont bien démontré.
J. D. : Oui cela nous ramène à la pragmatique, à tous les jeux de langage de Wittgenstein, ou à la vision pragmatique en linguistique où les conditions de parole sont extrêmement importantes dans le décodage du langage.
A. É. L. : Je pense à cet artiste qui s’appelle Benjamin Bennett et qui a fait une série de vidéos sur Internet qui s’appelle Sitting And Smiling, où il regarde la caméra assise en position de méditation en souriant sans arrêt pendant quatre heures. Il a fait plus de deux cents films de quatre heures filmés en temps réel à partir du « streaming ». Au départ, les internautes se posaient la même question « Est-ce que c’est quelqu’un qui a des troubles de la personnalité et qui trouve du temps pour faire cela? Ou est-ce une approche spirituelle d’une secte nouvelle ? Ou finalement, est-ce que c’est un artiste de performance ? » Puis, quand on lit l’entretien qui lui a été consacré par Vice après un an ou deux de pratique, on s’aperçoit qu’il sait très bien d’où il vient artistiquement, et qu’il fait cette action en donnant le moins d’indications possible sur ses intentions, que ce soit sur son site et sur YouTube. À un moment donné il déclare à Vice que Tehching Hsieh < http://www.tehchinghsieh.com/ > a été probablement son inspiration. Bien qu’il déclare être moins extrême que lui qui est resté un an dans la rue sans jamais rentrer nulle part , puis un an dans une cage sans parler, ou attaché sans arrêt pendant un an à Linda Montano, etc. Dans ce sens-là c’est intéressant d’observer à quel point des œuvres décontextualisées peuvent être perçues. Par contre, j’ai l’impression que tes œuvres en général sont assez contextualisées, à part peut-être GODDOG.
J. D. : Ce travail était plus direct. Voir mes oeuvres sur un écran de laptop, ça ne fonctionnerait pas, de plus on n’a pas le même type d’intimité quand on les voit chez soi. Le changement d’échelle est aussi très important. Il faut vraiment pénétrer l’espace public ou hacker Internet. Dans le cas de Tourmente ou de À portée de souffle, nous avons mobilisé des techniques qui permettent d’opérer sans utiliser des technologies « d’avant-garde ». On est resté dans l’analogique avec le moins de traitement numérique possible. On a capté le son à partir de téléphones cellulaires comme si c’était simplement des micros sans fils. On a ensuite utilisé un algorithme qui essaie de distinguer le souffle des autres sons, fiable à 80%, mais c’est suffisant pour que les gens suivent et comprennent. C’est étonnant de voir comment les gens suivent les instructions qu’on leur demande, et cela avec plaisir. Certains le font sans même se connecter à un wifi. Des fois, ils ont de la difficulté mais vont tout tenter pour réussir.
A. É. L. : C’est intéressant que tu dises que c’est très analogique comme technologie. On parle souvent d’ «art numérique» je m’interroge à ce propos, car dans plusieurs cas les trois quarts d’un dispositif sont analogiques. Une certaine partie des machines seulement est numérique. Cette dénomination d’art numérique est un peu étrange.
J. D. : Le numérique, c’est juste une façon de nous expliquer les états électroniques dans une machine. L’ordinateur gère de l’électricité. Il ne gère pas des nombres en fin de compte. Le zéro puis le un, ça nous dit simplement que l’électricité passe, ou ne passe pas dans certains circuits. C’est une représentation humaine, simplifiée. Tout ce qui est art numérique, c’est de l’art électronique qui a été soumis à une phase de développement supplémentaire. Il est important de ne pas faire de rupture entre ce qu’on pourrait appeler le monde analogique et le monde numérique. C’est simplement une question de convention technologique.
A. É. L. : D’autant plus que tu inscris ta pratique, comme tu le disais au début de l’entretien, dans les arts visuels. Tu ne dis pas faire des «arts technologiques».
J. D. : Je suis en arts visuels, spécialisé en arts médiatiques. Quand j’ai fait Zones franches, ce n’était qu’un projet parmi d’autres. Je ne voulais pas devenir un «artiste numérique». Je visais simplement à faire une œuvre avec un écran tactile. Je voulais réfléchir en tant qu’artiste visuel à l’impact du toucher dans la relation à l’image. Je voulais ensuite faire d’autre chose, quel que soit le médium.
Cela dit, en 1996, cela m’a fait reconnaître dans le milieu de l’art. À l’époque, tout le monde cherchait de l’art technologique. Entre 1996 et 2000, je n’ai pas fait de demandes d’exposition. On me suivait et on me demandait d’en faire encore. C’est presque encore le même cas aujourd’hui. C’est étonnant de voir comment cela a pu faciliter ma «carrière artistique». J’étais là au bon moment, au bon endroit, à la bonne époque, en utilisant les bons outils. « Être de son époque», c’est ce que je disais au début. Si demain matin, un autre modèle de transmission de l’information apparaissait, peut-être que j’ évoluerais vers cela.
Ce qui m’intéresse actuellement dans les productions en art numérique c’est le travail en collaboration et la fin de l’image de l’artiste individuel basée sur le « génie personnel ». D’ailleurs mes projets ont presque toujours été réalisés en collaboration.
A. É. L. : Notamment avec Lynn Hughes dans le collectif Interstices.
J. D. : Et cela pendant plusieurs années. Pour moi l’interstice, se trouve à l’opposé de l’interface. C’est une zone vide sans contact. Les interfaces existent pour combler les interstices. L’interface est un dispositif qui permet à deux choses hétérogènes de rentrer en relation.
Revenant à la notion rencontre et d’interface. On peut dire que l’interface est un dispositif qui permet la rencontre. Avec lynn on s’était dit : « Si on veut faire des interfaces, il faut réfléchir aux interstices» et on se demandait « Qu’est-ce qui nous irrite avec le numérique : le clavier, la souris et les maux de dos que le travail sur ordinateur provoque ! On ne peut interagir avec le numérique sans utiliser ces interfaces. On va faire des installations ou inventer des interfaces corporelles.» Lynn a travaillé avec le biofeedback. Moi, avec le toucher. D’autres artistes ont travaillé avec les rayons infrarouges pour détecter les positions des gens, le mouvement, même les vibrations sonores. Manon de Pauw avait utilisé les sons émis lorsque l’on dessine sur une table. Elle les a pris et utilisés comme interface pour animer des vidéos. À mesure que l’on dessinait, les vidéos changeaient ce qui était projeté sur les feuilles. Il se créait des boucles de rétroaction intéressantes.
L’enjeu du numérique aujourd’hui, c’est de créer de nouveaux rapports sociaux et pas seulement de transformer l’information. Les médias sociaux ont produit une autre grande transformation. C’est-à-dire que l’on peut communiquer entre nous, puis on peut créer des outils entre nous car on trouve que Facebook est un peu totalitaire. Si on cherchait un autre réseau, est-ce que l’on trouverait d’autres moyens de collaborer de manière plus parallèle et moins hiérarchique entre artistes et spectateurs ? Est-ce que l’on pourrait cocréer des choses ? En fait, je n’aime pas beaucoup l’idée de « cocréer », je cherche davantage à coopérer comme je l’ai fait avec mon collègue Ghyslain Gagnon de l’ÉTS. Nous avions prévu faire une projection un peu à la manière de Tourmente pour le 40e anniversaire de l’ÉTS, mais les fonds étaient insuffisants. Un peu par hasard, nous avions ensuite assisté à une réunion où il s’agissait de refaire l’éclairage d’un souterrain entre les deux immeubles de l’ÉTS. Nous avons profité de la combinaison de ce budget avec ce que l’on avait déjà afin de réaliser une installation qui servirait à la fois d’éclairage et d’œuvre d’art. »
A. É. L. : Ce n’était pas un programme officiel du 1% d’œuvre publique ?
J. D. : Cela émergeait de la collaboration. Ce n’était pas une commande. Nous étions invités pour « brainstormer » sur un autre problème qui ne nous concernait pas directement. Finalement, nous avons saisi l’occasion en jumelant ce budget au nôtre pour faire quelque chose plus original. Pas seulement de l’éclairage, pas juste une œuvre mais une intégration des deux.
Le lieu visé était un tunnel de service avec des tuyaux d’aération. Un endroit complètement ingrat et très laid où faire de l’art finalement. Ce n’était sûrement pas en y accrochant des tableaux qu’on l’aurait rendu plus beau. Il s’agissait aussi d’inciter les étudiants à passer par ce tunnel plutôt que de traverser la rue Notre-Dame qui est dangereuse d’accès. On a observé ce qui s’y passait : les gens passaient, revenaient. Cela créait un circuit de flux d’humains, un circuit de flux d’électricité. Il y avait des tuyaux électriques, des tuyaux d’air, des tuyaux probablement destinés au transport de liquides. On s’est dit : « Pourquoi ne pas ajouter d’autres tuyaux pour voir les flux que l’on imagine se transposer en lumière ?» On a ajouté une sorte de système de « plomberie » lumineuse interactive que l’on pouvait animer par le souffle. On y a utilisé des matériaux bruts, des boites électriques, des joints en métal. On a emprunté le même vocabulaire que les plombiers et que les électriciens. On a même fait installer le dispositif par des électriciens avec leur propre matériel afin que cela soit fait professionellement à la manière traditionnelle des électriciens avec juste quelques petites contraintes formelles pour rendre cela attrayant. Il y avait déjà d’autres tuyaux qui devenaient esthétiques à partir du moment où on ajoutait les nôtres. Ce lieu complètement ingrat pour l’art s’est transformé en exploitant sa propre « beauté ». On a révélé les qualités esthétiques du lieu en ajoutant, plutôt qu’en enlevant des tuyaux. Cela a créé une dynamique intéressante sur le plan formel. C’était vraiment logique avec les types de flux déjà présents dans cet espace. Les étudiants venaient nous voir en disant « C’est la première œuvre publique qu’on a dans l’école avec laquelle on se reconnaît ! » Il faut dire qu’elle a été fabriquée en partie avec des étudiants. Nous l’avons ainsi signé à plusieurs, ce qui n’est pas habituel dans le milieu de l’art où l’artiste, même s’il y a des collaborateurs, signe individuellement. On oublie trop souvent que, dans les romans par exemple, il y a beaucoup de gens autre que l’auteur qui interviennent. Souvent, les romans sont bons à cause du travail de l’éditeur, parfois plus que celui de l’écrivain, mais personne ne le sait. En arts visuels aussi, les peintres travaillent avec beaucoup de collaborateurs. Mais c’est le peintre qui signe. Certains peintres ne touchent même plus un pinceau mais ils signent leurs œuvres. On pense à Molinari qui était un grand peintre, mais qui faisait faire ses tableaux de A à Z par des assistants. Il envoyait des dessins et des pots de peinture pour les faire réaliser sur un canevas. À plus forte raison dans notre cas, il fallait signer ensemble, avec tous ceux qui ont créé, tous ceux qui ont eu des idées, comme s’il s’agissait d’un article scientifique. J’avais d’ailleurs signé un article scientifique avec eux puisque je leur avais donné l’occasion d’écrire sur la reconnaissance de forme. Si je pouvais être signataire de l’article scientifique, ils pouvaient aussi être signataires de l’œuvre d’art. Nous avons joué avec cette logique.
L’oeuvre produite s’intitule Le circuit de Bachelard puisque Bachelard a travaillé sur la poétique et sur l’épistémologie. C’est un grand penseur philosophique qui s’est intéressé autant à la pensée imaginative qu’à la pensée rationnelle et il savait illustrer que l’on peut fonctionner avec ces deux types de réflexion.
A. É. L. : Il est toujours possible d’aller voir ces œuvres sous les immeubles de l’ÉTS, au coin Notre-Dame et Peel à Montréal ou encore sà l’adresse www.jeandubois.info.
